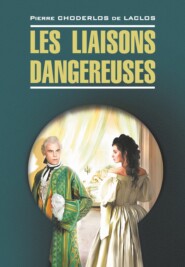скачать книгу бесплатно
Adieu, Vicomte, je vais me mettre à ma toilette où je lirai votre volume.
De …, ce 27 août 17**.
Lettre XXXIX. De Cécile Volanges à Sophie Carnay
Je suis triste et inquiète, ma chère Sophie. J’ai pleuré presque toute la nuit. Ce n’est pas que pour le moment je ne sois bien heureuse, mais je prévois que cela ne durera pas.
J’ai été hier à l’Opéra avec Mme de Merteuil. Nous y avons beaucoup parlé de mon mariage, et je n’en ai appris rien de bon. C’est M. le Comte de Gercourt que je dois épouser, et ce doit être au mois d’octobre. Il est riche, il est homme de qualité, il est colonel du régiment de… Jusques-là tout va fort bien. Mais d’abord il est vieux : figure-toi qu’il a au moins trente-six ans ! et puis, Mme de Merteuil dit qu’il est triste et sévère, et qu’elle craint que je ne sois pas heureuse avec lui. J’ai même bien vu qu’elle en était sûre, et qu’elle ne voulait pas me le dire, pour ne pas m’affliger. Elle ne m’a presque entretenue toute la soirée que des devoirs des femmes envers leurs maris : elle convient que M. de Gercourt n’est pas aimable du tout, et elle dit pourtant qu’il faudra que je l’aime. Ne m’a-t-elle pas dit aussi qu’une fois mariée, je ne devais plus aimer le Chevalier Danceny ? comme si c’était possible ! Oh ! je t’assure bien que je l’aimerai toujours. Vois-tu j’aimerais mieux, plutôt, ne me pas marier. Que ce M. de Gercourt s’arrange, je ne l’ai pas été chercher. Il est en Corse à présent, bien loin d’ici ; je voudrais qu’il y restât dix ans. Si je n’avais pas peur de rentrer au couvent, je dirais bien à Maman que je ne veux pas de ce mari-là ; mais ce serait encore pis. Je suis bien embarrassée. Je sens que je n’ai jamais tant aimé M. Danceny qu’à présent ; et quand je songe qu’il ne me reste plus qu’un mois à être comme je suis, les larmes me viennent aux yeux tout de suite ; je n’ai de consolation que dans l’amitié de Mme de Merteuil ; elle a si bon cœur ! elle partage tous mes chagrins comme moi-même ; et puis elle est si aimable, que, quand je suis avec elle, je n’y songe presque plus. D’ailleurs elle m’est bien utile ; car le peu que je sais, c’est elle qui me l’a appris, et elle est si bonne que je lui dis tout ce que je pense sans être honteuse du tout. Quand elle trouve que cela n’est pas bien, elle me gronde quelquefois ; mais c’est tout doucement, et puis je l’embrasse de tout mon cœur, jusqu’à ce qu’elle ne soit plus fâchée. Au moins celle-là, je peux bien l’aimer tant que je voudrai, sans qu’il y ait du mal, et ça me fait bien du plaisir. Nous sommes pourtant convenues que je n’aurais pas l’air de l’aimer tant devant le monde, et surtout devant Maman, afin qu’elle ne se méfie de rien au sujet du Chevalier Danceny. Je t’assure que si je pouvais vivre toujours comme je fais à présent, je crois que je serais bien heureuse. Il n’y a que ce vilain M. de Gercourt… Mais je ne veux pas t’en parler davantage, car je redeviendrais triste. Au lieu de cela, je vais écrire au Chevalier Danceny ; je ne lui parlerai que de mon amour, et non de mes chagrins, car je ne veux pas l’affliger.
Adieu, ma bonne amie. Tu vois bien que tu aurais tort de te plaindre, et que j’ai beau être occupée, comme tu dis, qu’il ne m’en reste pas moins le temps de t’aimer et de t’écrire[13 - On continue de supprimer les lettres de Cécile Volanges et du Chevalier Danceny, qui sont peu intéressantes, et n’annoncent aucun événement.].
De…, ce 27 août 17**.
Lettre XL. Le Vicomte de Valmont à la Marquise de Merteuil
C’est peu pour mon inhumaine de ne pas répondre à mes lettres, de refuser de les recevoir ; elle veut même me priver de sa vue, elle exige que je m’éloigne. Ce qui vous surprendra davantage, c’est que je me soumette à tant de rigueur. Vous allez me blâmer. Cependant je n’ai pas cru devoir perdre l’occasion de lui laisser me donner un ordre : persuadé, d’une part, que qui commande s’engage ; et de l’autre, que l’autorité illusoire que nous avons l’air de laisser prendre aux femmes, est un des pièges qu’elles évitent le plus difficilement. De plus, l’adresse qu’elle a su mettre à éviter de se trouver seule avec moi, me plaçait dans une situation dangereuse, dont j’ai cru devoir sortir à quelque prix que ce fût : car étant sans cesse avec elle, sans pouvoir l’occuper de mon amour, il y avait lieu de craindre qu’elle ne s’accoutumât enfin à me voir sans trouble ; disposition dont vous savez assez combien il est difficile de revenir.
Au reste, vous devinez que je ne me suis pas soumis sans condition. J’ai même eu le soin d’en mettre une impossible à accorder ; tant pour rester toujours maître de tenir ma parole, ou d’y manquer, que pour engager une discussion, soit de bouche, ou par écrit, dans un moment où ma belle est plus contente de moi, où elle a besoin que je le sois d’elle : sans compter que je serais bien maladroit, si je ne trouvais moyen d’obtenir quelque dédommagement de mon désistement à cette prétention, toute insoutenable qu’elle est.
Après vous avoir exposé mes raisons dans ce long préambule, je commence l’historique de ces deux derniers jours. J’y joindrai, comme pièces justificatives, la lettre de ma belle et ma réponse. Vous conviendrez qu’il y a peu d’historiens plus exacts que moi.
Vous vous rappelez l’effet que fit avant-hier matin ma lettre de Dijon ; le reste de la journée fut très orageux. La jolie prude arriva seulement au moment du dîner, et annonça une forte migraine ; prétexte dont elle voulut couvrir un des [plus] violents accès d’humeur que femme puisse avoir. Sa figure en était vraiment altérée ; l’expression de douceur que vous lui connaissez, s’était changée en un air mutin qui en faisait une beauté nouvelle. Je me promets bien de faire usage de cette découverte par la suite, et de remplacer quelquefois la maîtresse tendre, par la maîtresse mutine.
Je prévis que l’après-dînée serait triste ; et pour m’en sauver l’ennui, je prétextai des lettres à écrire, et me retirai chez moi. Je revins au salon sur les sept heures : Mme de Rosemonde proposa la promenade, qui fut acceptée. Mais au moment de monter en voiture, la prétendue malade, par une malice infernale, et peut-être pour se venger de mon absence, prétexta à son tour un redoublement de douleurs, et me fit subir sans pitié le tête-à-tête de ma vieille tante. Je ne sais si les imprécations que je fis contre ce démon femelle furent exaucées, mais nous la trouvâmes couchée au retour.
Le lendemain au déjeûner, ce n’était plus la même femme. La douceur naturelle était revenue, et j’eus lieu de me croire pardonné. Le déjeûner était à peine fini, que la douce personne se leva d’un air indolent et entra dans le parc ; je la suivis, comme vous pouvez croire. « D’où peut naître ce désir de promenade ? lui dis-je en l’abordant. – J’ai beaucoup écrit ce matin, me répondit-elle, et ma tête est un peu fatiguée. – Je ne suis pas assez heureux, repris-je, pour avoir à me reprocher cette fatigue-là. – Je vous ai bien écrit, répondit-elle encore, mais j’hésite à vous donner ma lettre. Elle contient une demande, et vous ne m’avez pas accoutumée à en espérer le succès. – Ah ! je jure que s’il est possible… – Rien n’est plus facile, interrompit-elle ; et quoique vous dussiez peut-être l’accorder comme justice, je consens à l’obtenir comme grâce. » En disant ces mots, elle me présenta sa lettre ; en la prenant, je pris aussi sa main, qu’elle retira, mais sans colère, et avec plus d’embarras que de vivacité. « La chaleur est plus vive que je ne croyais, dit-elle ; il faut rentrer. » Et elle reprit la route du château. Je fis de vains efforts pour lui persuader de continuer sa promenade, et j’eus besoin de me rappeller que nous pouvions être vus, pour n’y employer que de l’éloquence. Elle rentra sans proférer une parole, et je vis clairement que cette feinte promenade n’avait eu d’autre but que de me remettre sa lettre. Elle monta chez elle en rentrant ; et je me retirai chez moi pour lire l’épître, que vous ferez bien de lire aussi, ainsi que ma réponse, avant d’aller plus loin…
Lettre XLI. La Présidente de Tourvel au Vicomte de Valmont
Il semble, Monsieur, par votre conduite avec moi, que vous ne cherchiez qu’à augmenter chaque jour les sujets de plainte que j’avais contre vous. Votre obstination à vouloir m’entretenir sans cesse d’un sentiment que je ne veux ni ne dois écouter ; l’abus que vous n’avez pas craint de faire de ma bonne foi ou de ma timidité, pour me remettre vos lettres ; le moyen surtout, j’ose dire peu délicat, dont vous vous êtes servi pour me faire parvenir la dernière, sans craindre au moins l’effet d’une surprise qui pouvait me compromettre ; tout devrait donner lieu de ma part à des reproches aussi vifs que justement mérités. Cependant, au lieu de revenir sur ces griefs, je m’en tiens à vous faire une demande aussi simple que juste ; et si je l’obtiens de vous, je consens que tout soit oublié.
Vous-même m’avez dit, Monsieur, que je ne devais pas craindre un refus ; et quoique, par une inconséquence qui vous est particulière, cette phrase même soit suivie du seul refus que vous pouviez me faire[14 - Voyez lettre XXXV.], je veux croire que vous n’en tiendrez pas moins aujourd’hui cette parole formellement donnée il y a si peu de jours.
Je désire donc que vous ayez la complaisance de vous éloigner de moi ; de quitter ce château, où un plus long séjour de votre part ne pourrait que m’exposer davantage au jugement d’un public toujours prompt à mal penser d’autrui, et que vous n’avez que trop accoutumé à fixer les yeux sur les femmes qui vous admettent dans leur société.
Avertie déjà, depuis longtemps, de ce danger par mes amis, j’ai négligé, j’ai même combattu leur avis tant que votre conduite à mon égard avait pu me faire croire que vous aviez bien voulu ne me pas confondre avec cette foule de femmes qui toutes ont eu à se plaindre de vous. Aujourd’hui que vous me traitez comme elles, que je ne peux plus l’ignorer, je dois au public, à mes amis, à moi-même, de suivre ce parti nécessaire. Je pourrais ajouter ici que vous ne gagneriez rien à refuser ma demande, décidée que je suis à partir moi-même, si vous vous obstinez à rester : mais je ne cherche point à diminuer l’obligation que je vous aurai de cette complaisance, et je veux bien que vous sachiez qu’en nécessitant mon départ d’ici, vous contrarieriez mes arrangements. Prouvez-moi donc, Monsieur, que comme vous me l’avez dit tant de fois, les femmes honnêtes n’auront jamais à se plaindre de vous ; prouvez-moi, au moins, que quand vous avez des torts avec elles, vous savez les réparer.
Si je croyais avoir besoin de justifier ma demande vis-à-vis de vous, il me suffirait de vous dire que vous avez passé votre vie à la rendre nécessaire, et que pourtant il n’a pas tenu à moi de ne la jamais former. Mais ne rappelons pas des événements que je veux oublier, et qui m’obligeraient à vous juger avec rigueur, dans un moment où je vous offre l’occasion de mériter toute ma reconnaissance. Adieu, Monsieur ; votre conduite va m’apprendre avec quels sentiments je dois être, pour la vie, votre très humble, etc.
De…, ce 25 août 17**.
Lettre XLII. Le Vicomte de Valmont à la Présidente de Tourvel
Quelque dures que soient, Madame, les conditions que vous m’imposez, je ne refuse pas de les remplir. Je sens qu’il me serait impossible de contrarier aucun de vos désirs. Une fois d’accord sur ce point, j’ose me flatter qu’à mon tour, vous me permettrez de vous faire quelques demandes, bien plus faciles à accorder que les vôtres, et que pourtant je ne veux obtenir que de ma soumission parfaite à votre volonté.
L’une, que j’espère qui sera sollicitée par votre justice, est de vouloir bien me nommer enfin mes accusateurs auprès de vous ; ils me font, ce me semble, assez de mal pour que j’aie le droit de les connaître ; l’autre, que j’attends de votre indulgence, est de vouloir bien me permettre de vous renouveler quelquefois l’hommage d’un amour qui va plus que jamais mériter votre pitié.
Songez, Madame, que je m’empresse de vous obéir, lors même que je ne peux le faire qu’aux dépens de mon bonheur ; je dirai plus, malgré la persuasion où je suis, que vous ne désirez mon départ que pour vous sauver le spectacle, toujours pénible, de l’objet de votre injustice.
Convenez-en, Madame, vous craignez moins un public trop accoutumé à vous respecter pour oser porter de vous un jugement désavantageux, que vous n’êtes gênée par la présence d’un homme qu’il vous est plus facile de punir que de blâmer. Vous m’éloignez de vous comme on détourne ses regards d’un malheureux qu’on ne veut pas secourir.
Mais tandis que l’absence va redoubler mes tourments, à quelle autre qu’à vous puis-je adresser mes plaintes ? de quelle autre puis-je attendre des consolations qui vont me devenir si nécessaires ? Me les refuserez-vous, quand vous seule causez mes peines ?
Sans doute vous ne serez pas étonnée non plus, qu’avant de partir j’aie à cœur de justifier auprès de vous les sentiments que vous m’avez inspirés ; comme aussi que je ne trouve le courage de m’éloigner qu’en en recevant l’ordre de votre bouche.
Cette double raison me fait vous demander un moment d’entretien. Inutilement voudrions-nous y suppléer par lettres : on écrit des volumes, et l’on explique mal ce qu’un quart d’heure de conversation suffit pour faire bien entendre. Vous trouverez facilement le temps de me l’accorder : car quelque empressé que je sois de vous obéir, vous savez que Mme de Rosemonde est instruite de mon projet de passer chez elle une partie de l’automne, et il faudra au moins que j’attende de recevoir une lettre pour pouvoir prétexter une affaire qui me force à partir.
Adieu, Madame ; jamais ce mot ne m’a tant coûté à écrire que dans ce moment où il me ramène à l’idée de notre séparation. Si vous pouviez imaginer ce qu’elle me fait souffrir, j’ose croire que vous me sauriez quelque gré de ma docilité. Recevez au moins, avec plus d’indulgence, l’assurance et l’hommage de l’amour le plus tendre et le plus respectueux.
De …, ce 26 août 17**.
Suite de la lettre XL. Du Vicomte de Valmont à la Marquise de Merteuil
A présent, raisonnons, ma belle amie. Vous sentez comme moi que la scrupuleuse, l’honnête Mme de Tourvel, ne peut pas m’accorder la première de mes demandes, et trahir la confiance de ses amis, en me nommant mes accusateurs ; ainsi en promettant tout à cette condition, je ne m’engage à rien. Mais vous sentez aussi que ce refus qu’elle me fera deviendra un titre pour obtenir tout le reste ; et qu’alors je gagne, en m’éloignant, d’entrer avec elle, et de son aveu, en correspondance réglée : car je compte pour peu le rendez-vous que je lui demande, et qui n’a presque d’autre objet que de l’accoutumer d’avance à n’en pas refuser d’autres quand ils me seront vraiment nécessaires.
La seule chose qui me reste à faire avant mon départ, est de trouver un moyen de savoir quels sont les gens qui s’occupent à me nuire auprès d’elle. Je présume que c’est son pédant de mari ; je le voudrais : outre qu’une défense conjugale est un aiguillon au désir, je serais sûre que du moment qu’elle aura consenti à m’écrire, je n’aurais plus rien à craindre de ce côté, puisqu’elle se trouverait déjà dans la nécessité de le tromper.
Mais si elle a une amie assez intime pour avoir sa confidence, et que cette amie-là soit contre moi, il me paraît nécessaire de les brouiller, et je compte bien y réussir : mais avant tout il faut être instruit.
J’ai bien cru que j’allais l’être hier ; mais cette femme ne fait rien comme une autre. Nous étions chez elle au moment où on vint avertir que le dîner était servi. Sa toilette se finissait seulement, et tout en se pressant, et en faisant des excuses, je m’aperçus qu’elle laissait la clef à son secrétaire ; et je connais son usage de ne pas ôter celle de son appartement. J’y rêvais pendant le dîner, lorsque j’entendis descendre sa femme de chambre : je pris mon parti sur le champ ; je feignis un saignement de nez, et sortis. Je volai au secrétaire ; mais je trouvai tous les tiroirs ouverts, et pas un papier écrit. Cependant on n’a pas d’occasion de les brûler dans cette saison. Que fait-elle des lettres qu’elle reçoit ? et elle en reçoit souvent ! Je n’ai rien négligé ; tout était ouvert, et j’ai cherché partout ; mais je n’y ai rien gagné, que de me convaincre que ce dépôt précieux reste dans ses poches.
Comment l’en tirer ? depuis hier je m’occupe inutilement d’en trouver les moyens : cependant je ne peux en vaincre le désir. Je regrette de n’avoir pas le talent des filoux. Ne devrait-il pas, en effet, entrer dans l’éducation d’un homme qui se mêle d’intrigues ? ne serait-il pas plaisant de dérober la lettre ou le portrait d’un rival, ou de tirer des poches d’une prude de quoi la démasquer ? Mais nos parents ne songent à rien ; et moi j’ai beau songer à tout, je ne fais que m’apercevoir que je suis gauche, sans pouvoir y remédier.
Quoi qu’il en soit, je revins me mettre à table, fort mécontent. Ma belle calma pourtant un peu mon humeur, par l’air d’intérêt que lui donna ma feinte indisposition ; et je ne manquai pas de l’assurer que j’avais, depuis quelque temps, de violentes agitations qui altéraient ma santé. Persuadée, comme elle est, que c’est elle qui les cause, ne devrait-elle pas en conscience travailler à les calmer ? Mais, quoique dévote, elle est peu charitable ; elle refuse toute aumône amoureuse, et ce refus suffit bien, ce me semble, pour en autoriser le vol. Mais adieu ; car tout en causant avec vous, je ne songe qu’à ces maudites lettres.
De …, ce 27 août 17**.
Lettre XLIII. La Présidente de Tourvel au Vicomte de Valmont
Pourquoi chercher, Monsieur, à diminuer ma reconnaissance ? Pourquoi ne vouloir m’obliger qu’à demi, et marchander en quelque sorte un procédé honnête ? Il ne vous suffit donc pas que j’en sente le prix ? Non seulement vous demandez beaucoup, mais vous demandez des choses impossibles. Si en effet mes amis m’ont parlé de vous, ils ne l’ont pu faire que par intérêt pour moi : quand même ils se seraient trompés, leur intention n’en était pas moins bonne ; et vous me proposez de reconnaître cette marque d’attachement de leur part, en vous livrant leur secret ! J’ai déjà eu tort de vous en parler, et vous me le faites assez sentir dans ce moment. Ce qui n’eût été que de la candeur avec tout autre, devient une étourderie avec vous, et me mènerait à une noirceur, si je cédais à votre demande. J’en appelle à vous-même, à votre honnêteté ; m’avez-vous cru capable de ce procédé ? avez-vous dû me le proposer ? Non sans doute ; et je suis sûre qu’en y réfléchissant mieux, vous ne reviendrez plus sur cette demande.
Celle que vous me faites de m’écrire n’est guère plus facile à accorder ; et si vous voulez être juste, ce n’est pas à moi que vous vous en prendrez. Je ne veux point vous offenser ; mais avec la réputation que vous vous êtes acquise, et que, de votre aveu même, vous méritez, du moins en partie, quelle femme pourrait avouer être en correspondance avec vous ? et quelle femme honnête peut se déterminer à faire ce qu’elle sent qu’elle serait obligée de cacher ?
Encore, si j’étais assurée que vos lettres fussent telles que je n’eusse jamais à m’en plaindre, que je pusse toujours me justifier à mes yeux de les avoir reçues ! peut-être alors le désir de vous prouver que c’est la justice et non la haine qui me guide, me ferait passer par-dessus ces considérations puissantes, et faire beaucoup plus que je ne devrais, en vous permettant de m’écrire quelquefois. Si en effet vous le désirez autant que vous me le dites, vous vous soumettrez volontiers à la seule condition qui puisse m’y faire consentir ; et si vous avez quelque reconnaissance de ce que je fais pour vous dans ce moment, vous ne différerez plus de partir.
Permettez-moi de vous observer à ce sujet, que vous avez reçu une lettre ce matin, et que vous n’en avez pas profité pour annoncer votre départ à Mme de Rosemonde, comme vous me l’aviez promis. J’espère qu’à présent rien ne pourra vous empêcher de tenir votre parole. Je compte surtout que vous n’attendrez pas, pour cela, l’entretien que vous me demandez et auquel je ne veux absolument pas me prêter ; et qu’au lieu de l’ordre que vous prétendez vous être nécessaire, vous vous contenterez de la prière que je vous renouvelle. Adieu, Monsieur.
De …, ce 26 août 17**.
Lettre XLIV. Le Vicomte de Valmont à la Marquise de Merteuil
Partagez ma joie, ma belle amie ; je suis aimé ; j’ai triomphé de ce cœur rebelle. C’est en vain qu’il dissimule encore ; mon heureuse adresse a surpris son secret. Grâce à mes soins actifs, je sais tout ce qui m’intéresse : depuis la nuit, l’heureuse nuit d’hier, je me retrouve dans mon élément ; j’ai repris toute mon existence ; j’ai dévoilé un double mystère d’amour et d’iniquité : je jouirai de l’un, je me vengerai de l’autre ; je volerai de plaisirs en plaisirs. La seule idée que je m’en fais me transporte au point que j’ai quelque peine à rappeler ma prudence ; que j’en aurai peut-être à mettre de l’ordre dans le récit que j’ai à vous faire. Essayons cependant.
Hier même, après vous avoir écrit ma lettre, j’en reçus une de la céleste dévote. Je vous l’envoie ; vous y verrez qu’elle me donne, le moins maladroitement qu’elle peut, la permission de lui écrire : mais elle y presse mon départ, et je sentais bien que je ne pouvais le différer trop longtemps sans me nuire.
Tourmenté cependant du désir de savoir qui pouvait avoir écrit contre moi, j’étais encore incertain du parti que je prendrais. Je tentai de gagner la femme de chambre, et je voulus obtenir d’elle de me livrer les poches de sa Maîtresse, dont elle pouvait s’emparer aisément le soir, et qu’il lui était facile de replacer le matin, sans donner le moindre soupçon. J’offris dix louis pour ce léger service : mais je ne trouvai qu’une bégueule, scrupuleuse ou timide, que mon éloquence ni mon argent ne purent vaincre. Je la prêchais encore, quand le souper sonna. Il fallut la laisser ; trop heureux qu’elle voulût bien me promettre le secret, sur lequel même vous jugez que je ne comptais guère.
Jamais, je n’eus plus d’humeur. Je me sentais compromis ; et je me reprochai, toute la soirée, ma démarche imprudente.
Retiré chez moi, non sans inquiétude, je parlai à mon chasseur, qui, en sa qualité d’amant heureux, devait avoir quelque crédit. Je voulais, ou qu’il obtînt de cette fille de faire ce que je lui avais demandé, ou au moins qu’il s’assurât de sa discrétion ; mais lui, qui d’ordinaire ne doute de rien, parut douter du succès de cette négociation, et me fit à ce sujet une réflexion qui m’étonna par sa profondeur.
« Monsieur sait sûrement mieux que moi, me dit-il, que coucher avec une fille, ce n’est que lui faire faire ce qui lui plaît : de là à lui faire faire ce que nous voulons, il y a souvent bien loin. »
Le bon sens du Maraud quelquefois m’épouvante[15 - Piron, Métromanie.].
« Je réponds d’autant moins de celle-ci, ajouta-t-il, que j’ai lieu de croire qu’elle a un amant, et que je ne la dois qu’au désœuvrement de la campagne. Aussi, sans mon zèle pour le service de Monsieur, je n’aurais eu cela qu’une fois. » (C’est un vrai trésor que ce garçon ! ) « Quant au secret », ajouta-t-il encore, « à quoi servira-t-il de le lui faire promettre, puisqu’elle ne risquera rien à nous tromper ? Lui en reparler ne ferait que lui mieux apprendre qu’il est important, et par là lui donner plus d’envie d’en faire sa cour à sa maîtresse. »
Plus ces réflexions étaient justes, plus mon embarras augmentait. Heureusement le drôle était en train de jaser ; et comme j’avais besoin de lui, je le laissais faire. Tout en me racontant son histoire avec cette fille, il m’apprit que, comme la chambre qu’elle occupe n’est séparée de celle de sa maîtresse que par une simple cloison, qui pouvait laisser entendre un bruit suspect, c’était dans la sienne qu’ils se rassemblaient chaque nuit. Aussitôt je formai mon plan ; je le lui communiquai, et nous l’exécutâmes avec succès.
J’attendis deux heures du matin ; et alors je me rendis, comme nous en étions convenus, à la chambre du rendez-vous, portant de la lumière avec moi et sous le prétexte d’avoir sonné plusieurs fois inutilement. Mon confident, qui joue ses rôles à merveille, donna une petite scène de surprise, de désespoir et d’excuse, que je terminai en l’envoyant me faire chauffer de l’eau, dont je feignis avoir besoin ; tandis que la scrupuleuse chambrière était d’autant plus honteuse, que le drôle qui avait voulu renchérir sur mes projets l’avait déterminée à une toilette que la saison comportait, mais qu’elle n’excusait pas.
Comme je sentais que plus cette fille serait humiliée, plus j’en disposerais facilement, je ne lui permis de changer ni de situation ni de parure ; et après avoir ordonné à mon valet de m’attendre chez moi, je m’assis à côté d’elle sur le lit qui était fort en désordre, et je commençai ma conversation. Comme j’avais besoin de garder l’empire que la circonstance me donnait sur elle, je conservai un sang-froid qui eût fait honneur à la continence de Scipion, et sans prendre la plus petite liberté avec elle, ce que pourtant sa fraîcheur et l’occasion semblaient lui donner le droit d’espérer, je lui parlai d’affaires aussi tranquillement que j’aurais pu faire avec un procureur.
Mes conditions furent que je garderais fidèlement le secret, pourvu que le lendemain, à pareille heure ou à peu près, elle me livrât les poches de sa maîtresse. « Au reste, ajoutai-je, je vous avais offert dix louis hier ; je vous les promets encore aujourd’hui. Je ne veux pas abuser de votre situation. » Tout fut accordé, comme vous pouvez croire et je me retirais, quand je m’aperçus que mon valet avait emporté mon flambeau au lieu du sien, ce qui donna occasion à une gaîté de ma part. Je priai la belle de me conduire et m’éclairer. Elle voulut faire au moins auparavant un commencement de toilette : mais je l’assurai qu’après ce qui venait de se passer, nous pouvions être sans façon et, tant bien que mal, il lui fallut se prêter à cette plaisanterie. Elle vint ainsi jusques chez moi, et là, je la remis à son tendre amant, en permettant à l’heureux couple d’aller réparer le temps perdu.
J’employai le mien à dormir ; et à mon réveil, voulant trouver un prétexte pour ne pas répondre à la lettre de ma belle avant d’avoir visité ses papiers, ce que je ne pouvais faire que la nuit suivante, je me décidai à aller à la chasse, où je restai presque tout le jour.
A mon retour, je fus reçu assez froidement. J’ai lieu de croire qu’on fut un peu piqué du peu d’empressement que je mettais à profiter du temps qui me restait ; surtout après la lettre plus douce que l’on m’avait écrite. J’en juge ainsi, sur ce que Mme de Rosemonde m’ayant fait quelques reproches sur cette longue absence, ma belle reprit avec un peu d’aigreur : « Ah ! ne reprochons pas à M. de Valmont de se livrer au seul plaisir qu’il peut trouver ici. » Je me plaignis de cette injustice, et j’en profitai pour assurer que je me plaisais tant à être avec ces Dames, que j’y sacrifiais une lettre très intéressante que j’avais à écrire. J’ajoutai que, ne pouvant trouver le sommeil depuis plusieurs nuits, j’avais voulu essayer si la fatigue me le rendrait ; et mes regards expliquaient assez et le sujet de ma lettre, et la cause de mon insomnie. J’eus soin d’avoir toute la soirée une douceur mélancolique, qui me parut réussir assez bien, et sous laquelle je masquai l’impatience où j’étais de voir arriver l’heure qui devait me livrer le secret qu’on s’obstinait à me cacher. Enfin nous nous séparâmes, et quelque temps après, la fidèle femme de chambre vint m’apporter le prix convenu de ma discrétion.
Une fois maître de ce trésor, je procédai à l’inventaire avec la prudence que vous me connaissez : car il était important de remettre tout en place. Je tombai d’abord sur deux lettres du mari, mélange indigeste de détails de procès et de tirades d’amour conjugal, que j’eus la patience de lire en entier, et où je ne trouvai pas un mot qui eût rapport à moi. Je les replaçai avec humeur : mais elle s’adoucit, en trouvant sous ma main les morceaux de ma fameuse lettre de Dijon, soigneusement rassemblés. Heureusement il me prit fantaisie de la parcourir. Jugez de ma joie, en y apercevant les traces bien distinctes des larmes de mon adorable dévote. Je l’avoue, je cédai à un mouvement de jeune homme, et baisai cette lettre avec un transport dont je ne me croyais plus susceptible. Je continuai l’heureux examen ; je retrouvai toutes mes lettres de suite, et par ordre de dates ; et ce qui me surprit plus agréablement encore, fut de trouver la première de toutes, celle que je croyais m’avoir été rendue par une ingrate, fidèlement copiée de sa main ; et d’une écriture altérée et tremblante, qui témoignait assez la douce agitation de son cœur pendant cette occupation.
Jusque-là j’étais tout entier à l’amour ; bientôt il fit place à la fureur. Qui croyez-vous qui veuille me perdre auprès de cette femme que j’adore ? quelle furie supposez-vous assez méchante, pour tramer une pareille noirceur ? Vous la connaissez : c’est votre amie, votre parente ; c’est Mme de Volanges. Vous n’imaginez pas quel tissu d’horreurs l’infernale mégère lui a écrit sur mon compte. C’est elle, elle seule, qui a troublé la sécurité de cette femme angélique ; c’est par ses conseils, par ses avis pernicieux, que je me vois forcé de m’éloigner ; c’est à elle enfin que l’on me sacrifie. Ah ! sans doute il faut séduire sa fille : mais ce n’est pas assez, il faut la perdre ; et puisque l’âge de cette maudite femme la met à l’abri de mes coups, il faut la frapper dans l’objet de ses affections.
Elle veut donc que je revienne à Paris ! elle m’y force ! soit, j’y retournerai ; mais elle gémira de mon retour. Je suis fâché que Danceny soit le héros de cette affaire ; il a un fond d’honnêteté qui nous gênera : cependant il est amoureux, et je le vois souvent ; on pourra peut-être en tirer parti. Je m’oublie dans ma colère et je ne songe pas que je vous dois le récit de ce qui s’est passé aujourd’hui. Revenons.
Ce matin j’ai revu ma sensible prude. Jamais je ne l’avais trouvée si belle. Cela devait être ainsi : le plus beau moment d’une femme, le seul où elle puisse produire cette ivresse de l’âme, dont on parle toujours et qu’on éprouve si rarement, est celui où, assurés de son amour, nous ne le sommes pas de ses faveurs ; et c’est précisément le cas où je me trouvais. Peut-être aussi l’idée que j’allais être privé du plaisir de la voir servait-elle à l’embellir. Enfin, à l’arrivée du courrier, on m’a remis votre lettre du 27 ; et pendant que je la lisais, j’hésitais encore pour savoir si je tiendrais ma parole : mais j’ai rencontré les yeux de ma belle, et il m’aurait été impossible, dans ce moment, de lui rien refuser.
J’ai donc annoncé mon départ. Un moment après, Mme de Rosemonde nous a laissés seuls : mais j’étais encore à quatre pas de la farouche personne, que se levant avec l’air de l’effroi : « Laissez-moi, laissez-moi, Monsieur, m’a-t-elle dit, au nom de Dieu, laissez-moi. » Cette prière fervente, qui décelait son émotion, ne pouvait que m’animer davantage. Déjà j’étais auprès d’elle, et je tenais ses mains qu’elle avait jointes avec une expression tout à fait touchante ; là je commençais de tendres plaintes, quand un démon ennemi a ramené Mme de Rosemonde. La timide dévote, qui a en effet quelque raison de craindre, en a profité pour se retirer.
Je lui ai pourtant offert la main qu’elle a acceptée ; et augurant bien de cette douceur, qu’elle n’avait pas eue depuis longtemps, tout en recommençant mes plaintes j’ai essayé de la serrer. Elle a d’abord voulu la retirer ; mais sur une instance plus vive, elle s’est livrée d’assez bonne grâce, quoique sans répondre ni à ce geste, ni à mes discours. Arrivés à la porte de son appartement, j’ai voulu baiser cette main, avant de la quitter. La défense a commencé par être franche ; mais un songez donc que je pars, prononcé bien tendrement, l’a rendue gauche et insuffisante. A peine le baiser a-t-il été donné, que la main a retrouvé sa force pour échapper, et que la belle est entrée dans son appartement où était sa femme de chambre. Là finit mon histoire.
Comme je présume que vous serez demain chez la Maréchale de…, où sûrement je n’irai pas vous trouver ; comme je me doute bien aussi qu’à notre première entrevue nous aurons plus d’une affaire à traiter, et notamment celle de la petite Volanges, que je ne perds pas de vue, j’ai pris le parti de me faire précéder par cette lettre ; et toute longue qu’elle est, je ne la fermerai qu’au moment de l’envoyer à la poste : car au terme où j’en suis, tout peut dépendre d’une occasion ; et je vous quitte pour aller l’épier.
P. S. à huit heures du soir.
Rien de nouveau ; pas le plus petit moment de liberté ; du soin même pour l’éviter. Cependant, autant de tristesse que la décence en permettait, pour le moins. Un autre événement qui peut ne pas être indifférent, c’est que je suis chargé d’une invitation de Mme de Rosemonde à Madame de Volanges, pour venir passer quelque temps chez elle à la campagne.
Adieu, ma belle amie, à demain ou après-demain au plus tard.
De …, ce 28 août 17**.
Lettre XLV. La Présidente de Tourvel à Madame de Volanges
Monsieur de Valmont est parti ce matin, Madame ; vous m’avez paru tant désirer ce départ, que j’ai cru devoir vous en instruire. Madame de Rosemonde regrette beaucoup son neveu, dont il faut convenir qu’en effet la société est agréable : elle a passé toute la matinée à m’en parler avec la sensibilité que vous lui connaissez ; elle ne tarissait pas sur son éloge. J’ai cru lui devoir la complaisance de l’écouter sans la contredire, d’autant qu’il faut avouer qu’elle avait raison sur beaucoup de points. Je sentais de plus que j’avais à me reprocher d’être la cause de cette séparation, et je n’espère pas pouvoir la dédommager du plaisir dont je l’ai privée. Vous savez que j’ai naturellement peu de gaieté, et le genre de vie que nous allons mener ici n’est pas fait pour l’augmenter.
Si je ne m’étais pas conduite d’après vos avis, je craindrais d’avoir agi peut être un peu légèrement : car j’ai été vraiment peinée de la douleur de ma respectable amie ; elle m’a touchée au point que j’aurais volontiers mêlé mes larmes aux siennes.
Nous vivons à présent dans l’espoir que vous accepterez l’invitation que M. de Valmont doit vous faire, de la part de Mme de Rosemonde, de venir passer quelque temps chez elle. J’espère que vous ne doutez pas du plaisir que j’aurai à vous y voir ; et en vérité vous nous devez ce dédommagement. Je serai fort aise de trouver cette occasion de faire une connaissance plus prompte avec Mlle de Volanges, et d’être à portée de vous convaincre de plus en plus des sentiments respectueux, avec lesquels j’ai l’honneur d’être, etc.
De …, 29 août 17**.
Lettre XLVI. Le Chevalier Danceny à Cécile Volanges
Que vous est-il donc arrivé, mon adorable Cécile ? qui a pu causer en vous un changement si prompt et si cruel ? que sont devenus vos serments de ne jamais changer ? Hier encore, vous les réitériez avec tant de plaisir ! qui peut aujourd’hui vous les faire oublier ? J’ai beau m’examiner, je ne puis en trouver la cause en moi, et il m’est affreux d’avoir à la chercher en vous. Ah ! sans doute vous n’êtes ni légère, ni trompeuse ; et même dans ce moment de désespoir, un soupçon outrageant ne flétrira point mon âme. Cependant, par quelle fatalité n’êtes-vous plus la même ? Non, cruelle, vous ne l’êtes plus ! La tendre Cécile, la Cécile que j’adore, et dont j’ai reçu les serments, n’aurait point évité mes regards, n’aurait pas contrarié le hasard heureux qui me plaçait auprès d’elle ; ou si quelque raison que je ne peux concevoir l’avait forcée à me traiter avec tant de rigueur, elle n’eût pas au moins dédaigné de me l’apprendre.
Ah ! vous ne savez pas, vous ne saurez jamais, ma Cécile, ce que vous m’avez fait souffrir aujourd’hui, ce que je souffre encore en ce moment. Croyez-vous donc que je puisse vivre et ne plus être aimé de vous ? Cependant, quand je vous ai demandé un mot, un seul mot, pour dissiper mes craintes, au lieu de me répondre, vous avez feint de craindre d’être entendue ; et cet obstacle qui n’existait pas alors, vous l’avez fait naître aussitôt, par la place que vous avez choisie dans le cercle. Quand, forcé de vous quitter, je vous ai demandé l’heure à laquelle je pourrais vous revoir demain, vous avez feint de l’ignorer, et il a fallu que ce fût Mme de Volanges qui m’en instruisît. Ainsi ce moment toujours si désiré qui doit me rapprocher de vous demain, ne fera naître en moi que de l’inquiétude ; et le plaisir de vous voir, jusqu’alors si cher à mon cœur, sera remplacé par la crainte de vous être importun.
Déjà, je le sens, cette crainte m’arrête, et je n’ose vous parler de mon amour. Ce je vous aime, que j’aimais tant à répéter quand je pouvais l’entendre à mon tour, ce mot si doux qui suffisait à ma félicité, ne m’offre plus, si vous êtes changée, que l’image d’un désespoir éternel. Cependant, je ne puis croire que ce talisman de l’amour ait perdu toute sa puissance, et j’essaie de m’en servir encore[16 - Ceux qui n’ont pas eu occasion de sentir quelquefois le prix d’un mot, d’une expression, consacrés par l’amour, ne trouveront aucun sens dans cette phrase.]. Oui, ma Cécile, je vous aime. Répétez donc avec moi cette expression de mon bonheur. Songez que vous m’avez accoutumé à l’entendre, et que m’en priver, c’est me condamner à un tourment qui, de même que mon amour, ne finira qu’avec ma vie.
De …, ce 29 août 17**.
Lettre XLVII. Le Vicomte de Valmont à la Marquise de Merteuil
Je ne vous verrai pas encore aujourd’hui, ma belle amie, et voici mes raisons, que je vous prie de recevoir avec indulgence.
Au lieu de revenir hier directement, je me suis arrêté chez la Comtesse de ***, dont le château se trouvait presque sur ma route, et à qui j’ai demandé à dîner. Je ne suis arrivé à Paris que vers les sept heures, et je suis descendu à l’Opéra, où j’espérais que vous pourriez être.
L’opéra fini, j’ai été revoir mes amies du foyer ; j’y ai retrouvé mon ancienne Émilie, entourée d’une cour nombreuse, tant en femmes qu’en hommes, à qui elle donnait à souper le soir même à P… Je ne fus pas plutôt entré dans ce cercle, que je fus prié du souper, par acclamation. Je le fus aussi par une petite figure grosse et courte, qui me baragouina une invitation en français de Hollande, et que je reconnus pour le véritable héros de la fête. J’acceptai.
J’appris, dans ma route, que la maison où nous allions était le prix convenu des bontés d’Émilie pour cette figure grotesque, et que ce souper était un véritable repas de noce. Le petit homme ne se possédait pas de joie, dans l’attente du bonheur dont il allait jouir ; il m’en parut si satisfait, qu’il me donna envie de le troubler ; ce que je fis en effet.
La seule difficulté que j’éprouvai fut de décider Émilie, que la richesse du bourgmestre rendait un peu scrupuleuse. Elle se prêta pourtant, après quelques façons, au projet que je donnai, de remplir de vin ce petit tonneau à bière, et de le mettre ainsi hors de combat pour toute la nuit.
L’idée sublime que nous nous étions formée d’un buveur Hollandais, nous fit employer tous les moyens connus. Nous réussîmes si bien, qu’au dessert il n’avait déjà plus la force de tenir son verre : mais la secourable Émilie et moi l’entonnions à qui mieux mieux. Enfin, il tomba sous la table, dans une ivresse telle, qu’elle doit au moins durer huit jours. Nous nous décidâmes alors à le renvoyer à Paris ; et comme il n’avait pas gardé sa voiture, je le fis charger dans la mienne, et je restai à sa place. Je reçus ensuite les compliments de l’assemblée, qui se retira bientôt après, et me laissa maître du champ de bataille. Cette gaieté, et peut-être ma longue retraite, m’ont fait trouver Émilie si désirable, que je lui ai promis de rester avec elle jusqu’à la résurrection du Hollandais.
Cette complaisance de ma part est le prix de celle qu’elle vient d’avoir, de me servir de pupitre pour écrire à ma belle dévote, à qui j’ai trouvé plaisant d’envoyer une lettre écrite du lit et presque dans les bras d’une fille, interrompue même pour une infidélité complète, et dans laquelle je lui rendis un compte exact de ma situation et de ma conduite. Émilie, qui a lu l’épître, en a ri comme une folle, et j’espère que vous en rirez aussi.
Comme il faut que ma lettre soit timbrée de Paris, je vous l’envoie ; je la laisse ouverte. Vous voudrez bien la lire, la cacheter, et la faire mettre à la poste. Surtout n’allez pas vous servir de votre cachet, ni même d’aucun emblème amoureux ; une tête seulement. Adieu, ma belle amie.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: