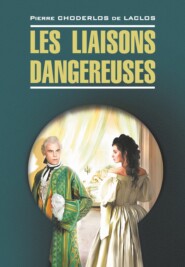скачать книгу бесплатно
J’ai cru, et c’est là mon seul tort, j’ai cru que vous respecteriez une femme honnête, qui ne demandait pas mieux que de vous trouver tel et de vous rendre justice ; qui déjà vous défendait, tandis que vous l’outragiez par vos vœux criminels. Vous ne me connaissez pas ; non, Monsieur, vous ne me connaissez pas. Sans cela, vous n’auriez pas cru pouvoir vous faire un droit de vos torts : parce que vous m’avez tenu des discours que je ne devais pas entendre, vous ne vous seriez pas cru autorisé à m’écrire une lettre que je ne devais pas lire : et vous me demandez de guider vos démarches, de dicter vos discours ! Hé bien, Monsieur, le silence et l’oubli, voilà les conseils qu’il me convient de vous donner, comme à vous de suivre : alors, vous aurez, en effet, des droits à mon indulgence : il ne tiendrait qu’à vous d’en obtenir même à ma reconnaissance… Mais non, je ne ferai point une demande à celui qui ne m’a point respectée ; je ne donnerai point une marque de confiance à celui qui a abusé de ma sécurité. Vous me forcez à vous craindre, peut-être à vous haïr : je ne le voulais pas ; je ne voulais voir en vous que le neveu de ma plus respectable amie ; j’opposais la voix de l’amitié à la voix publique qui vous accusait. Vous avez tout détruit ; et, je le prévois, vous ne voudrez rien réparer.
Je m’en tiens, Monsieur, à vous déclarer que vos sentiments m’offensent, que leur aveu m’outrage, et surtout que, loin d’en venir un jour à les partager, vous me forceriez à ne vous revoir jamais, si vous ne vous imposiez sur cet objet un silence qu’il me semble avoir droit d’attendre, et même d’exiger de vous. Je joins à cette lettre celle que vous m’avez écrite, et j’espère que vous voudrez bien de même me remettre celle-ci ; je serais vraiment peinée qu’il restât aucune trace d’un événement qui n’eût jamais dû exister. J’ai l’honneur d’être, etc.
De …, ce 21 août 17**.
Lettre XXVII. Cécile Volanges à la Marquise de Merteuil
Mon Dieu, que vous êtes bonne, Madame ! comme vous avez bien senti qu’il me serait plus facile de vous écrire que de vous parler ! Aussi, c’est que ce que j’ai à vous dire est bien difficile ; mais vous êtes mon amie, n’est-il pas vrai ? Oh ! oui, ma bien bonne amie ! Je vais tâcher de ne pas avoir peur ; et puis, j’ai tant besoin de vous, de vos conseils ! J’ai bien du chagrin ; il me semble que tout le monde devine ce que je pense ; et surtout quand il est là, je rougis dès qu’on me regarde. Hier, quand vous m’avez vue pleurer, c’est que je voulais vous parler, et puis, je ne sais quoi m’en empêchait ; et quand vous m’avez demandé ce que j’avais, mes larmes sont venues malgré moi. Je n’aurais pas pu dire une parole. Sans vous, Maman allait s’en apercevoir, et qu’est-ce que je serais devenue ? Voilà pourtant comme je passe ma vie , surtout depuis quatre jours !
C’est ce jour-là, Madame, oui, je vais vous le dire, c’est ce jour-là que M. le Chevalier Danceny m’a écrit : oh ! je vous assure que quand j’ai trouvé sa lettre, je ne savais pas du tout ce que c’était. Mais, pour ne pas mentir, je ne peux pas dire que je n’aie eu bien du plaisir en la lisant. Voyez-vous, j’aimerais mieux avoir du chagrin toute ma vie, que s’il ne me l’eût pas écrite ! Mais je savais bien que je ne devais pas le lui dire, et je peux bien vous assurer même que je lui ai dit que j’en étais fâchée : mais il dit que c’était plus fort que lui, et je le crois bien ; car j’avais résolu de ne lui pas répondre, et pourtant je n’ai pas pu m’en empêcher. Oh ! je ne lui ai écrit qu’une fois, et même c’était, en partie, pour lui dire de ne plus m’écrire : mais malgré cela il m’écrit toujours ; et comme je ne lui réponds pas, je vois bien qu’il est triste, et ça m’afflige encore davantage : si bien que je ne sais plus que faire, ni que devenir, et que je suis bien à plaindre.
Dites-moi, je vous en prie, Madame, est-ce que ce serait bien mal de lui répondre de temps en temps ? seulement jusqu’à ce qu’il ait pu prendre sur lui de ne plus m’écrire lui-même, et de rester comme nous étions avant : car, pour moi, si cela continue, je ne sais pas ce que je deviendrai. Tenez, en lisant sa dernière lettre, j’ai pleuré, que ça ne finissait pas ; et je suis sûre que si je ne lui réponds pas encore, cela nous fera bien de la peine.
Je vais vous envoyer sa lettre aussi, ou bien une copie, et vous jugerez ; vous verrez bien que ce n’est rien de mal qu’il demande. Cependant si vous trouvez que ça ne se doit pas, je vous promets de m’en empêcher ; mais je crois que vous penserez comme moi, que ce n’est pas là du mal.
Pendant que j’y suis, Madame, permettez-moi de vous faire encore une question : on m’a bien dit que c’était mal d’aimer quelqu’un ; mais pourquoi cela ? Ce qui me fait vous le demander, c’est que M. le Chevalier Danceny prétend que ça n’est pas mal du tout, et que presque tout le monde aime ; si cela était, je ne vois pas pourquoi je serais la seule à m’en empêcher ; ou bien est-ce que ce n’est un mal que pour les demoiselles ? car j’ai entendu Maman elle-même dire que Mme D… aimait M. M… et elle n’en parlait pas comme d’une chose qui serait si mal ; et pourtant je suis sûre qu’elle se fâcherait contre moi, si elle se doutait seulement de mon amitié pour M. Danceny. Elle me traite toujours comme un enfant, Maman ; et elle ne me dit rien du tout. Je croyais, quand elle m’a fait sortir du couvent, que c’était pour me marier ; mais à présent il me semble que non : ce n’est pas que je m’en soucie, je vous assure ; mais vous, qui êtes si amie avec elle, vous savez peut-être ce qui en est, et si vous le savez, j’espère que vous me le direz.
Voilà une bien longue lettre, Madame , mais puisque vous m’avez permis de vous écrire, j’en ai profité pour vous dire tout, et je compte sur votre amitié.
J’ai l’honneur d’être, etc.
Paris, ce 23 août 17**.
Lettre XXVIII. Du Chevalier Danceny à Cécile Volanges
Eh ! quoi, Mademoiselle, vous refusez toujours de me répondre ! rien ne peut vous fléchir ; et chaque jour emporte avec lui l’espoir qu’il avait amené ! Quelle est donc cette amitié que vous consentez qui subsiste entre nous, si elle n’est pas même assez puissante pour vous rendre sensible à ma peine ? si elle vous laisse froide et tranquille, tandis que j’éprouve tous les tourments d’un feu que je ne puis éteindre ? si loin de vous inspirer de la confiance, elle ne suffit pas même pour faire naître votre pitié ? Quoi ! votre ami souffre et vous ne faites rien pour le secourir ? Il ne vous demande qu’un mot, et vous le lui refusez ? et vous voulez qu’il se contente d’un sentiment si faible, dont vous craignez encore de lui réitérer les assurances ?
Vous ne voudriez pas être ingrate, disiez-vous hier ! ah ! croyez-moi, Mademoiselle ; vouloir payer de l’amour avec de l’amitié, ce n’est pas craindre l’ingratitude, c’est redouter seulement d’en avoir l’air. Cependant je n’ose plus vous entretenir d’un sentiment qui ne peut que vous être à charge, s’il ne vous intéresse pas ; il faut au moins le renfermer en moi-même, en attendant que j’apprenne à le vaincre. Je sens combien ce travail sera pénible ; je ne me dissimule pas que j’aurai besoin de toutes mes forces ; je tenterai tous les moyens : il en est un qui coûtera le plus à mon cœur, ce sera celui de me répéter souvent que le vôtre est insensible. J’essaierai même de vous voir moins, et déjà je m’occupe d’en trouver un prétexte plausible.
Quoi ! je perdrais la douce habitude de vous voir chaque jour ! Ah ! du moins je ne cesserai jamais de la regretter. Un malheur éternel sera le prix de l’amour le plus tendre ; et vous l’aurez voulu, et ce sera votre ouvrage ! Jamais, je le sens, je ne retrouverai le bonheur que je perds aujourd’hui ; vous seule étiez faite pour mon cœur ; avec quel plaisir je ferais le serment de ne vivre que pour vous ! Mais vous ne voulez pas le recevoir ; votre silence m’apprend assez que votre cœur ne vous dit rien pour moi ; il est à la fois la preuve la plus sûre de votre indifférence, et la manière la plus cruelle de me l’annoncer. Adieu, Mademoiselle.
Je n’ose plus me flatter d’une réponse ; l’amour l’eût écrite avec empressement, l’amitié avec plaisir, la pitié même avec complaisance : mais la pitié, l’amitié et l’amour sont également étrangers à votre cœur.
Paris, ce 23 août 17**.
Lettre XXIX. Cécile Volanges à Sophie Carnay
Je te le disais bien, Sophie, qu’il y avait des cas où on pouvait écrire ; et je t’assure que je me reproche bien d’avoir suivi ton avis, qui nous a tant fait de peine, au Chevalier Danceny et à moi. La preuve que j’avais raison, c’est que Mme de Merteuil, qui est une femme qui sûrement le sait bien, a fini par penser comme moi. Je lui ai tout avoué. Elle m’a bien dit d’abord comme toi : mais quand je lui ai eu tout expliqué, elle est convenue que c’était bien différent ; elle exige seulement que je lui fasse voir toutes mes lettres et toutes celles du Chevalier Danceny, afin d’être sûre que je ne dirai que ce qu’il faudra ; ainsi, à présent, me voilà tranquille. Mon Dieu, que je l’aime Mme de Merteuil ! elle est si bonne ! et c’est une femme bien respectable. Ainsi il n’y a rien à dire.
Comme je m’en vais écrire à M. Danceny, et comme il va être content ! il le sera encore plus qu’il ne croit : car jusqu’ici je ne lui parlais que de mon amitié, et lui il voulait toujours que je dise mon amour. Je crois que c’était bien la même chose ; mais enfin je n’osais pas, et il tenait à cela. Je l’ai dit à Mme de Merteuil ; elle m’a dit que j’avais eu raison, et qu’il ne fallait convenir d’avoir de l’amour, que quand on ne pouvait plus s’en empêcher : or je suis bien sûre que je ne pourrai pas m’en empêcher plus longtemps ; après tout c’est la même chose, et cela lui plaira davantage.
Mme de Merteuil m’a dit aussi qu’elle me prêterait des livres, qui parlaient de tout cela, et qui m’apprendraient bien à me conduire, et aussi à mieux écrire que je ne fais : car, vois-tu, elle me dit tous mes défauts, ce qui est une preuve qu’elle m’aime bien ; elle m’a recommandé seulement de ne rien dire à Maman de ces livres-là, parce que ça aurait l’air de trouver qu’elle a trop négligé mon éducation, et ça pourrait la fâcher. Oh ! je ne lui en dirai rien.
C’est pourtant bien extraordinaire qu’une femme qui ne m’est presque pas parente, prenne plus de soin de moi que ma mère ! c’est bien heureux pour moi de l’avoir connue !
Elle a demandé aussi à Maman de me mener après-demain à l’Opéra, dans sa loge ; elle m’a dit que nous y serions toutes seules, et nous causerons tout le temps, sans craindre qu’on nous entende ; j’aime bien mieux cela que l’Opéra. Nous causerons aussi de mon mariage : car elle m’a dit que c’était bien vrai que j’allais me marier ; mais nous n’avons pas pu en dire davantage. Par exemple, n’est-ce pas encore bien étonnant que Maman ne m’en dise rien du tout ?
Adieu, ma Sophie, je m’en vais écrire à M. le Chevalier Danceny. Oh ! je suis bien contente.
De …, ce 24 août 17**.
Lettre XXX. Cécile Volanges au Chevalier Danceny
Enfin, Monsieur, je consens à vous écrire, à vous assurer de mon amitié, de mon amour, puisque, sans cela, vous seriez malheureux. Vous dites que je n’ai pas bon cœur ; je vous assure bien que vous vous trompez, et j’espère qu’à présent vous n’en doutez plus. Si vous avez eu du chagrin de ce que je ne vous écrivais pas, croyez-vous que ça ne me faisait pas de la peine aussi ? Mais c’est que, pour toute chose au monde, je ne voudrais pas faire quelque chose qui fût mal ; et même je ne serais sûrement pas convenue de mon amour, si j’avais pu m’en empêcher : mais votre tristesse me faisait trop de peine. J’espère qu’à présent vous n’en aurez plus, et que nous allons être bien heureux.
Je compte avoir le plaisir de vous voir ce soir, et que vous viendrez de bonne heure ; ce ne sera jamais aussi tôt que je le désire. Maman soupe chez elle, et je crois qu’elle vous proposera d’y rester : j’espère que vous ne serez pas engagé, comme avant-hier. C’était donc bien agréable, le souper où vous alliez, car vous y avez été de bien bonne heure ? Mais enfin ne parlons pas de ça : à présent que vous savez que je vous aime, j’espère que vous resterez avec moi le plus que vous pourrez ; car je ne suis contente que lorsque je suis avec vous, et je voudrais bien que vous fussiez tout de même.
Je suis bien fâchée que vous êtes encore triste à présent, mais ce n’est pas ma faute. Je demanderai à jouer de la harpe aussitôt que vous serez arrivé, afin que vous ayez ma lettre tout de suite. Je ne peux pas mieux faire.
Adieu, Monsieur. Je vous aime bien, de tout mon cœur : plus je vous le dis, plus je suis contente ; j’espère que vous le serez aussi.
De …, ce 24 août 17**.
Lettre XXXI. Le Chevalier Danceny à Cécile Volanges
Oui, sans doute, nous serons heureux. Mon bonheur est bien sûr, puisque je suis aimé de vous ; le vôtre ne finira jamais, s’il doit durer autant que l’amour que vous m’avez inspiré. Quoi ! vous m’aimez, vous ne craignez plus de m’assurer de votre amour ! Plus vous me le dites, et plus vous êtes contente ! Après avoir lu ce charmant je vous aime, écrit de votre main, j’ai entendu votre belle bouche m’en répéter l’aveu. J’ai vu se fixer sur moi ces yeux charmants, qu’embellissait encore l’expression de la tendresse. J’ai reçu vos serments de vivre toujours pour moi. Ah ! recevez le mien de consacrer ma vie entière à votre bonheur ; recevez-le, et soyez sûre que je ne le trahirai pas.
Quelle heureuse journée nous avons passée hier ! Ah ! pourquoi Mme de Merteuil n’a-t-elle pas tous les jours des secrets à dire à votre Maman ? pourquoi faut-il que l’idée de la contrainte qui nous attend vienne se mêler au souvenir délicieux qui m’occupe ? pourquoi ne puis-je sans cesse tenir cette jolie main qui m’a écrit je vous aime ! la couvrir de baisers, et me venger ainsi du refus que vous m’avez fait d’une faveur plus grande ?
Dites-moi, ma Cécile, quand votre Maman a été rentrée ; quand nous avons été forcés, par sa présence, de n’avoir plus l’un pour l’autre que des regards indifférents ; quand vous ne pouviez plus me consoler par l’assurance de votre amour, du refus que vous faisiez de m’en donner des preuves, n’avez-vous donc senti aucun regret ? ne vous êtes-vous pas dit : Un baiser l’eût rendu plus heureux, et c’est moi qui lui ai ravi ce bonheur ? Promettez-moi, mon aimable amie, qu’à la première occasion vous serez moins sévère. A l’aide de cette promesse, je trouverai du courage pour supporter les contrariétés que les circonstances nous préparent ; et les privations cruelles seront au moins adoucies, par la certitude que vous en partagez le regret.
Adieu, ma charmante Cécile : voici l’heure où je dois me rendre chez vous. Il me serait impossible de vous quitter, si ce n’était pour aller vous revoir. Adieu, vous que j’aime tant ! vous, que j’aimerai toujours davantage !
De …, ce 25 août 17**.
Lettre XXXII. Madame de Volanges à la Présidente de Tourvel
Vous voulez donc, Madame, que je croie à la vertu de M. de Valmont ? J’avoue que je ne puis m’y résoudre, et que j’aurais autant de peine à le juger honnête, d’après le fait isolé que vous me racontez, qu’à croire vicieux un homme de bien reconnu, dont j’apprendrais une faute. L’humanité n’est parfaite dans aucun genre, pas plus dans le mal que dans le bien. Le scélérat a ses vertus, comme l’honnête homme a ses faiblesses. Cette vérité me paraît d’autant plus nécessaire à croire, que c’est d’elle que dérive la nécessité de l’indulgence pour les méchants comme pour les bons, et qu’elle préserve ceux-ci de l’orgueil, et sauve les autres du découragement. Vous trouverez sans doute que je pratique bien mal, dans ce moment, cette indulgence que je prêche ; mais je ne vois plus en elle qu’une faiblesse dangereuse, quand elle nous mène à traiter de même le vicieux et l’homme de bien.
Je ne me permettrai point de scruter les motifs de l’action de M. de Valmont ; je veux les croire louables comme elle : mais en a-t-il moins passé sa vie à porter dans les familles le trouble, le déshonneur et le scandale ? Ecoutez, si vous voulez, la voix du malheureux qu’il a secouru, mais qu’elle ne vous empêche pas d’entendre les cris de cent victimes qu’il a immolées. Quand il ne serait, comme vous le dites, qu’un exemple du danger des liaisons, en serait-il moins lui-même une liaison dangereuse ? Vous le supposez susceptible d’un retour heureux ? Allons plus loin ; supposons ce miracle arrivé : ne resterait-il pas contre lui l’opinion publique, et ne suffit-elle pas pour régler votre conduite ? Dieu seul peut absoudre au moment du repentir ; il lit dans les cœurs ; mais les hommes ne peuvent juger les pensées que par les actions ; et nul d’entre eux, après avoir perdu l’estime des autres, n’a droit de se plaindre de la méfiance nécessaire, qui la lui rend si difficile à recouvrer. Songez surtout, ma jeune amie, que quelquefois il suffit, pour la perdre, d’avoir l’air d’y attacher trop peu de prix ; et ne taxez pas cette sévérité d’injustice ; car, outre qu’on est fondé à croire qu’on ne renonce pas à ce bien précieux quand on a droit d’y prétendre, celui-là est en effet plus près de mal faire, qui n’est plus contenu par ce frein puissant. Tel serait cependant l’aspect sous lequel vous montrerait une liaison intime avec M. de Valmont, quelque innocente qu’elle pût être.
Effrayée de la chaleur avec laquelle vous le défendez, je me hâte de prévenir les objections que je prévois. Vous me citerez Madame de Merteuil ; à qui on a pardonné cette liaison ; vous me demanderez pourquoi je le reçois chez moi : vous me direz que, loin d’être rejeté par les gens honnêtes, il est admis, recherché même dans ce qu’on appelle la bonne compagnie. Je peux, je crois, répondre à tout.
D’abord Mme de Merteuil, en effet très estimable, n’a peut-être d’autre défaut que trop de confiance en ses forces ; c’est un guide adroit qui se plaît à conduire un char entre les rochers et les précipices, et que le succès seul justifie : il est juste de la louer, il serait imprudent de la suivre ; elle-même en convient et s’en accuse. A mesure qu’elle a vu davantage, ses principes sont devenus plus sévères ; et je ne crains pas de vous assurer qu’elle-même penserait comme moi.
Quant à ce qui me regarde, je ne me justifierai pas plus que les autres. Sans doute je reçois M. de Valmont, et il est reçu partout ; c’est une inconséquence de plus à ajouter à mille autres qui gouvernent la société. Vous savez, comme moi, qu’on passe sa vie à les remarquer, à s’en plaindre et à s’y livrer. M. de Valmont, avec un beau nom, une grande fortune, beaucoup de qualités aimables, a reconnu de bonne heure que pour avoir l’empire dans la société, il suffisait de manier, avec une égale adresse, la louange et le ridicule. Nul ne possède comme lui ce double talent : il séduit avec l’un, et se fait craindre avec l’autre. On ne l’estime pas ; mais on le flatte. Telle est son existence au milieu d’un monde qui, plus prudent que courageux, aime mieux le ménager que le combattre.
Mais ni Mme de Merteuil elle-même, ni aucune autre femme, n’oserait sans doute aller s’enfermer à la campagne, presque en tête-à-tête avec un tel homme. Il était réservé à la plus sage, à la plus modeste d’entr’elles, de donner l’exemple de cette inconséquence ; pardonnez-moi ce mot, il échappe à l’amitié. Ma belle amie, votre honnêteté même vous trahit, par la sécurité qu’elle vous inspire. Songez donc que vous aurez pour juges, d’une part, des gens frivoles, qui ne croiront pas à une vertu dont ils ne trouvent pas le modèle chez eux ; et de l’autre, des méchants qui feindront de n’y pas croire, pour vous punir de l’avoir eue. Considérez que vous faites, dans ce moment, ce que quelques hommes n’oseraient pas risquer. En effet, parmi les jeunes gens, dont M. de Valmont ne s’est que trop rendu l’oracle, je vois les plus sages craindre de paraître liés trop intimement avec lui ; et vous, vous ne le craignez pas ! Ah ! revenez, revenez, je vous en conjure. Si mes raisons ne suffisent pas pour vous persuader, cédez à mon amitié ; c’est elle qui me fait renouveler mes instances, c’est à elle à les justifier. Vous la trouvez sévère, et je désire qu’elle soit inutile ; mais j’aime mieux que vous ayez à vous plaindre de sa sollicitude que de sa négligence.
De…, ce 24 août 17**.
Lettre XXXIII. La Marquise de Merteuil au Vicomte de Valmont
Dès que vous craignez de réussir, mon cher Vicomte, dès que votre projet est de fournir des armes contre vous, et que vous désirez moins de vaincre que de combattre, je n’ai plus rien à dire. Votre conduite est un chef-d’œuvre de prudence. Elle en serait un de sottise dans la supposition contraire ; et, pour vous parler vrai, je crains que vous ne vous fassiez illusion.
Ce n’est pas de n’avoir pas profité du moment que je vous reproche. D’une part, je ne vois pas clairement qu’il fût venu ; de l’autre, je sais assez que, quoi qu’on en dise, une occasion manquée se retrouve, tandis qu’on ne revient jamais d’une démarche précipitée.
Mais la véritable école est de vous être laissé aller à écrire. Je vous défie de prévoir à présent où ceci peut vous mener. Par hasard, espérez-vous prouver à cette femme qu’elle doit se rendre ? Il me semble que ce ne peut être là qu’une vérité de sentiment, et non de démonstration ; et que pour la faire recevoir, il s’agit d’attendrir et non de raisonner ; mais à quoi vous servirait d’attendrir par lettres, puisque vous ne seriez pas là pour en profiter ? Quand vos belles phrases produiraient une ivresse assez forte pour décider cette femme, vous flattez-vous qu’elle soit assez longue pour que la réflexion n’ait pas le temps d’en empêcher l’aveu ? Songez donc au temps qu’il faut pour écrire une lettre, à celui qui se passe avant qu’on la remette ; et voyez si, surtout une femme à principes comme votre Dévote, peut vouloir si longtemps ce qu’elle tâche de ne vouloir jamais. Cette marche peut réussir avec des enfants, qui, quand ils écrivent je vous aime, ne savent pas qu’ils disent je me rends. Mais la vertu raisonneuse de Mme de Tourvel me paraît fort bien connaître la valeur des termes. Aussi, malgré l’avantage que vous aviez pris sur elle dans votre conversation, elle vous bat dans sa lettre. Et puis, savez-vous ce qui arrive ? par cela seul qu’on dispute, on ne veut pas céder. A force de chercher de bonnes raisons, on en trouve, on les dit ; et après on y tient, non pas tant parce qu’elles sont bonnes que pour ne se pas démentir.
De plus, une remarque que je m’étonne que vous n’ayez pas faite, c’est qu’il n’y a rien de si difficile en amour, que d’écrire ce qu’on ne sent pas. Je dis encore d’une façon vraisemblable : ce n’est pas qu’on ne se serve des mêmes mots, mais on ne les arrange pas de même, ou plutôt on les arrange, et cela suffit. Relisez votre lettre : il y règne un ordre qui vous décèle à chaque phrase. Je veux croire que votre Présidente est assez peu formée pour ne s’en pas apercevoir ; mais qu’importe ? l’effet n’en est pas moins manqué. C’est le défaut des romans ; l’auteur se bat les flancs pour s’échauffer, et le lecteur reste froid. Héloïse est le seul qu’on en puisse excepter ; et malgré le talent de l’auteur, cette observation m’a toujours fait croire que le fonds en était vrai. Il n’en est pas de même en parlant. L’habitude de travailler son organe y donne de la sensibilité ; la facilité des larmes y ajoute encore : l’expression du désir se confond dans les yeux avec celle de la tendresse ; enfin le discours moins suivi amène plus aisément cet air de trouble et de désordre, qui est la véritable éloquence de l’amour ; et surtout la présence de l’objet aimé empêche la réflexion et nous fait désirer d’être vaincues.
Croyez-moi, Vicomte : on vous demande de ne plus écrire ; profitez-en pour réparer votre faute, et attendez l’occasion de parler. Savez-vous que cette femme a plus de force que je ne croyais ? sa défense est bonne ; et, sans la longueur de sa lettre, et le prétexte qu’elle vous donne, pour rentrer en matière dans sa phrase de reconnaissance elle ne se serait pas du tout trahie.
Ce qui me paraît encore devoir vous rassurer sur le succès, c’est qu’elle use trop de forces à la fois ; je prévois qu’elle les épuisera pour la défense du mot, et qu’il ne lui en restera plus pour celle de la chose.
Je vous renvoie vos deux lettres, et si vous êtes prudent, ce seront les dernières jusqu’après l’heureux moment. S’il était moins tard, je vous parlerais de la petite Volanges, qui avance assez vite, et dont je suis fort contente. Je crois que j’aurai fini avant vous, et vous devez en être bien honteux. Adieu pour aujourd’hui.
De …, ce 24 août 17**.
Lettre XXXIV. Le Vicomte de Valmont à la Marquise de Merteuil
Vous parlez à merveille, ma belle amie ; mais pourquoi vous tant fatiguer à prouver ce que personne n’ignore ? Pour aller vite en amour, il vaut mieux parler qu’écrire ; voilà, je crois, toute votre lettre. Eh mais ! ce sont les plus simples éléments de l’art de séduire. Je remarquerai seulement que vous ne faites qu’une exception à ce principe, et qu’il y en a deux. Aux enfants qui suivent cette marche par timidité et se livrent par ignorance, il faut joindre les femmes beaux-esprits, qui s’y laissent engager par amour-propre, et que la vanité conduit dans le piège. Par exemple, je suis bien sûr que la Comtesse de B., qui répondit sans difficulté à ma première lettre, n’avait pas alors plus d’amour pour moi que moi pour elle, et qu’elle ne vit que l’occasion de traiter un sujet qui devait lui faire honneur.
Quoiqu’il en soit, un avocat vous dirait que le principe ne s’applique pas à la question. En effet, vous supposez que j’ai le choix entre écrire et parler, ce qui n’est pas. Depuis l’affaire du 19, mon inhumaine, qui se tient sur la défensive, a mis à éviter les rencontres une adresse qui a déconcerté la mienne. C’est au point que, si cela continue, elle me forcera à m’occuper sérieusement d’en trouver les moyens : car assurément je ne souffrirai d’être vaincu par elle en aucun genre. Mes lettres mêmes sont le sujet d’une petite guerre : non contente de n’y pas répondre, elle refuse de les recevoir. Il faut pour chacune une ruse nouvelle, et qui ne réussit pas toujours.
Vous vous rappelez par quel moyen simple j’avais remis la première ; la seconde n’offrit pas plus de difficulté. Elle m’avait demandé de lui rendre sa lettre : je lui donnai la mienne en place, sans qu’elle eût le moindre soupçon. Mais soit dépit d’avoir été attrapée, soit caprice, ou enfin soit vertu, car elle me forcera d’y croire, elle refusa obstinément la troisième. J’espère pourtant que l’embarras où a pensé la mettre la suite de ce refus, la corrigera pour l’avenir.
Je ne fus pas très étonné qu’elle ne voulût pas recevoir cette lettre, que je lui offrais tout simplement ; c’eût été déjà accorder quelque chose, et je m’attends à une plus longue défense. Après cette tentative, qui n’était qu’un essai fait en passant, je mis une enveloppe à ma lettre ; et prenant le moment de la toilette, où Mme de Rosemonde et la femme de chambre étaient présentes, je la lui envoyai par mon chasseur, avec ordre de lui dire que c’était le papier qu’elle m’avait demandé. J’avais bien deviné qu’elle craindrait l’explication scandaleuse que nécessiterait un refus : en effet, elle prit la lettre ; et mon ambassadeur, qui avait ordre d’observer sa figure, et qui ne voit pas mal, n’aperçut qu’une légère rougeur et plus d’embarras que de colère.
Je me félicitais donc : bien sûr, ou qu’elle garderait cette lettre, ou que si elle voulait me la rendre, il faudrait qu’elle se trouvât seule avec moi, ce qui me donnerait une occasion de lui parler. Environ une heure après, un de ses gens entre dans ma chambre et me remet, de la part de sa maîtresse, un paquet d’une autre forme que le mien, et sur l’enveloppe duquel je reconnais l’écriture tant désirée. J’ouvre avec précipitation. C’était ma lettre elle-même, non décachetée et pliée seulement en deux. Je soupçonne que la crainte que je ne fusse moins scrupuleux qu’elle sur le scandale, lui a fait employer cette ruse diabolique.
Vous me connaissez ; je n’ai pas besoin de vous peindre ma fureur. Il fallut pourtant reprendre son sang-froid, et chercher de nouveaux moyens. Voici le seul que je trouvai.
On va d’ici, tous les matins, chercher les lettres à la poste, qui est environ à trois quarts de lieue : on se sert, pour cet objet, d’une boîte couverte à peu près comme un tronc, dont le maître de la poste a une clef et Mme de Rosemonde l’autre. Chacun y met ses lettres dans la journée, quand bon lui semble : on les porte le soir à la poste, et le matin on va chercher celles qui sont arrivées. Tous les gens, étrangers ou autres, font ce service également. Ce n’était pas le tour de mon domestique ; mais il se chargea d’y aller, sous le prétexte qu’il avait affaire de ce côté.
Cependant j’écrivis ma lettre. Je déguisai mon écriture pour l’adresse, et je contrefis assez bien, sur l’enveloppe, le timbre de Dijon. Je choisis cette ville, parce que je trouvai plus gai, puisque je demandais les mêmes droits que le mari, d’écrire aussi du même lieu ; et aussi parce que ma belle avait parlé toute la journée du désir qu’elle avait de recevoir des lettres de Dijon. Il me parut juste de lui procurer ce plaisir.
Ces précautions une fois prises, il était facile de faire joindre cette lettre aux autres. Je gagnais encore à cet expédient d’être témoin de la réception : car l’usage est ici de se rassembler pour déjeuner, et d’attendre l’arrivée des lettres avant de se séparer. Enfin elles arrivèrent.
Mme de Rosemonde ouvrit la boîte. « De Dijon », dit-elle, en donnant la lettre à Madame de Tourvel. – « Ce n’est pas l’écriture de mon mari », reprit celle-ci d’une voix inquiète, en rompant le cachet avec vivacité ; le premier coup d’œil l’instruisit ; et il se fit une telle révolution sur sa figure, que Mme de Rosemonde s’en aperçut, et lui dit : « Qu’avez-vous ? » Je m’approchai aussi, en disant : « Cette lettre est donc bien terrible ? » La timide dévote n’osait lever les yeux, ne disait mot, et, pour sauver son embarras, feignait de parcourir l’épître, qu’elle n’était guère en état de lire. Je jouissais de son trouble ; et n’étant pas fâché de la pousser un peu : « Votre air plus tranquille, ajoutai-je, fait espérer que cette lettre vous a causé plus d’étonnement que de douleur. » La colère alors l’inspira mieux que n’eût pu faire la prudence. « Elle contient, répondit-elle, des choses qui m’offensent, et que je suis étonnée qu’on ait osé m’écrire. » « Et qui donc ? » interrompit Mme de Rosemonde. « Elle n’est pas signée, » répliqua la belle courroucée : « Mais la lettre et son auteur m’inspirent un égal mépris. On m’obligera de ne m’en plus parler. » En disant ces mots, elle déchira l’audacieuse missive, en mit les morceaux dans sa poche, se leva et sortit.
Malgré cette colère, elle n’en a pas moins eu ma lettre ; et je m’en remets bien à sa curiosité, du soin de l’avoir lue en entier.
Le détail du reste de la journée me mènerait trop loin. Je joins à ce récit le brouillon de mes deux lettres ; vous serez aussi instruite que moi. Si vous voulez être au courant de cette correspondance, il faut vous accoutumer à déchiffrer mes minutes : car pour rien au monde, je ne dévorerais l’ennui de les recopier. Adieu, ma belle amie.
De …, ce 25 août 17**.
Lettre XXXV. Le Vicomte de Valmont à la Présidente de Tourvel
Il faut vous obéir, Madame ; il faut vous prouver qu’au milieu des torts que vous vous plaisez à me croire, il me reste au moins assez de délicatesse pour ne pas me permettre un reproche, et assez de courage pour m’imposer les plus douloureux sacrifices. Vous m’ordonnez le silence et l’oubli ! eh bien ! je forcerai mon amour à se taire ; et j’oublierai, s’il est possible, la façon cruelle dont vous l’avez accueilli. Sans doute, le désir de vous plaire n’en donnait pas le droit ; et j’avoue encore que le besoin que j’avais de votre indulgence, ne faisait pas un titre pour y prétendre : mais vous regardez mon amour comme un outrage ; vous oubliez que si ce pouvait être un tort, vous en seriez à la fois et la cause et l’excuse. Vous oubliez aussi, qu’accoutumé à vous ouvrir mon âme, lors même que cette confiance pouvait me nuire, il ne m’était plus possible de vous cacher les sentiments dont vous l’avez pénétrée ; et ce qui fut l’ouvrage de ma bonne foi, vous le regardez comme le fruit de l’audace. Pour prix de l’amour le plus tendre, le plus vrai, le plus respectueux, vous me rejettez loin de vous. Vous me parlez enfin de votre haine. Quel autre ne se plaindrait pas d’être traité ainsi ? Moi seul, je me soumets ; je souffre tout et ne murmure point ; vous frappez, et j’adore. L’inconcevable empire que vous avez sur moi vous rend maîtresse absolue de mes sentiments ; et si mon amour seul vous résiste, si vous ne pouvez le détruire, c’est qu’il est votre ouvrage et non pas le mien.
Je ne demande point un retour dont jamais je ne me suis flatté. Je n’attends pas même cette pitié, que l’intérêt que vous m’aviez témoigné quelquefois pouvait me faire espérer. Mais je crois, je l’avoue, pouvoir réclamer votre justice.
Vous m’apprenez, Madame, qu’on a cherché à me nuire dans votre esprit. Si vous en eussiez cru les conseils de vos amis, vous ne m’eussiez pas laissé même approcher de vous ; ce sont vos termes. Quels sont donc ces amis officieux ? Sans doute ces gens si sévères, et d’une vertu si rigide, consentent à être nommés ; sans doute ils ne voudraient pas se couvrir d’une obscurité qui les confondrait avec de vils calomniateurs ; et je n’ignorerai ni leur nom, ni leurs reproches. Songez, Madame, que j’ai le droit de savoir l’un et l’autre, puisque vous me jugez d’après eux. On ne condamne point un coupable sans lui dire son crime, sans lui nommer ses accusateurs. Je ne demande point d’autre grâce, et je m’engage d’avance à me justifier, à les forcer de se dédire.
Si j’ai trop méprisé, peut-être, les vaines clameurs d’un public dont je fais peu de cas, il n’en est pas ainsi de votre estime ; et quand je consacre ma vie à la mériter, je ne me la laisserai pas ravir impunément. Elle me devient d’autant plus précieuse, que je lui devrai sans doute cette demande que vous craignez de me faire, et qui me donnerait, dites-vous, des droits à votre reconnaissance. Ah ! loin d’en exiger, je croirai vous en devoir, si vous me procurez l’occasion de vous être agréable. Commencez donc à me rendre plus de justice, en ne me laissant plus ignorer ce que vous désirez de moi. Si je pouvais le deviner, je vous éviterais la peine de le dire. Au plaisir de vous voir, ajoutez le bonheur de vous servir, et je me louerai de votre indulgence. Qui peut donc vous arrêter ? ce n’est pas, je l’espère, la crainte d’un refus ? je sens que je ne pourrais vous la pardonner. Ce n’en est pas un que de ne pas vous rendre votre lettre. Je désire, plus que vous, qu’elle ne me soit plus nécessaire : mais accoutumé à vous croire une âme si douce, ce n’est que par elle que je puis vous voir telle que vous voulez être pour moi. Quand je forme le vœu de vous rendre sensible, elle me rappelle que, plutôt que d’y consentir, vous fuiriez à cent lieues de moi ; quand tout en vous augmente et justifie mon amour, c’est encore elle qui me répète que mon amour vous outrage ; et lorsqu’en vous voyant, cet amour me semble le bien suprême, j’ai besoin de vous lire, pour sentir que ce n’est qu’un affreux tourment. Vous concevez à présent que mon plus grand bonheur serait de pouvoir vous rendre cette lettre fatale : me la demander encore, serait m’autoriser à ne plus croire ce qu’elle contient ; vous ne doutez pas, j’espère, de mon empressement à vous la remettre.
De …, ce 21 août 17**.
Lettre XXXVI. Le Vicomte de Valmont à la Présidente de Tourvel
(Timbrée de Dijon.)
Votre sévérité augmente chaque jour, Madame, et, si je l’ose dire, vous semblez craindre moins l’injustice que l’indulgence. Après m’avoir condamné sans m’entendre, vous avez dû sentir, en effet, qu’il vous serait plus facile de ne pas lire mes raisons que d’y répondre. Vous refusez mes lettres avec obstination ; vous me les renvoyez avec mépris. Vous me forcez enfin de recourir à la ruse, dans le moment même où mon unique but est de vous convaincre de ma bonne foi. La nécessité où vous m’avez mis de me défendre suffira sans doute pour en excuser les moyens. Convaincu d’ailleurs par la sincérité de mes sentiments, que pour les justifier à vos yeux il me suffit de vous les faire bien connaître, j’ai cru pouvoir me permettre ce léger détour. J’ose croire aussi que vous me le pardonnerez ; et que vous serez peu surprise que l’amour soit plus ingénieux à se produire, que l’indifférence à l’écarter.
Permettez donc, Madame, que mon cœur se dévoile entièrement à vous. Il vous appartient, il est juste que vous le connaissiez.
J’étais bien éloigné, en arrivant chez Mme de Rosemonde, de prévoir le sort qui m’y attendait. J’ignorais que vous y fussiez ; et j’ajouterai, avec la sincérité qui me caractérise, que quand je l’aurais su, ma sécurité n’en eût point été troublée : non que je rendisse à votre beauté la justice qu’on ne peut lui refuser ; mais accoutumé à n’éprouver que des désirs, à ne me livrer qu’à ceux que l’espoir encourageait, je ne connaissais pas les tourments de l’amour.
Vous fûtes témoin des instances que me fit Mme de Rosemonde pour m’arrêter quelque temps. J’avais déjà passé une journée avec vous : cependant je ne me rendis, ou au moins je ne crus me rendre qu’au plaisir, si naturel et si légitime, de témoigner des égards à une parente respectable. Le genre de vie qu’on menait ici différait beaucoup sans doute de celui auquel j’étais accoutumé ; il ne m’en coûta rien de m’y conformer ; et sans chercher à pénétrer la cause du changement qui s’opérait en moi, je l’attribuais uniquement encore à cette facilité de caractère, dont je crois vous avoir déjà parlé.
Malheureusement (et pourquoi faut-il que ce soit un malheur ?) en vous connaissant mieux je reconnus bientôt que cette figure enchanteresse, qui seule m’avait frappé, était le moindre de vos avantages ; votre âme céleste étonna, séduisit la mienne. J’admirais la beauté, j’adorai la vertu. Sans prétendre à vous obtenir, je m’occupai à vous mériter. En réclamant votre indulgence pour le passé, j’ambitionnai votre suffrage pour l’avenir. Je le cherchais dans vos discours, je l’épiais dans vos regards ; dans ces regards d’où partait un poison d’autant plus dangereux, qu’il était répandu sans dessein, et reçu sans méfiance.
Alors je connus l’amour. Mais que j’étais loin de m’en plaindre ! résolu de l’ensevelir dans un éternel silence, je me livrais sans crainte comme sans réserve à ce sentiment délicieux. Chaque jour augmentait son empire. Bientôt le plaisir de vous voir se changea en besoin. Vous absentiez-vous un moment ? mon cœur se serrait de tristesse ; au bruit qui m’annonçait votre retour, il palpitait de joie. Je n’existais plus que par vous, et pour vous. Cependant c’est vous-même que j’adjure : jamais dans la gaieté des folâtres jeux, ou dans l’intérêt d’une conversation sérieuse, m’échappa-t-il un mot qui pût trahir le secret de mon cœur ?
Enfin ce jour arriva où devait commencer mon infortune ; et par une inconcevable fatalité, une action honnête en devint le signal. Oui, Madame, c’est au milieu des malheureux que j’avais secourus, que, vous livrant à cette sensibilité précieuse qui embellit la beauté même et ajoute du prix à la vertu, vous achevâtes d’égarer un cœur que déjà trop d’amour enivrait. Vous vous rappellerez, peut-être, quelle préoccupation s’empara de moi au retour ! Hélas ! je cherchais à combattre un penchant que je sentais devenir plus forte que moi.
C’est après avoir épuisé mes forces dans ce combat trop inégal, qu’un hasard, que je n’avais pu prévoir, me fit trouver seul avec vous. Là, je succombai, je l’avoue. Mon cœur trop plein ne put retenir ses discours ni ses larmes. Mais est-ce donc un crime ? et si c’en est un, n’est-il pas assez puni par les tourments affreux auxquels je suis livré ?
Dévoré par un amour sans espoir, j’implore votre pitié et ne trouve que votre haine : sans autre bonheur que celui de vous voir, mes yeux vous cherchent malgré moi, et je tremble de rencontrer vos regards. Dans l’état cruel où vous m’avez réduit, je passe les jours à déguiser mes peines, et les nuits à m’y livrer ; tandis que vous, tranquille et paisible, vous ne connaissez ces tourments que pour les causer et vous en applaudir. Cependant c’est vous qui vous plaignez, et c’est moi qui m’excuse.
Voilà pourtant, Madame, voilà le récit fidèle de ce que vous nommez mes torts, et que peut-être il serait plus juste d’appeler mes malheurs. Un amour pur et sincère, un respect qui ne s’est jamais démenti, une soumission parfaite ; tels sont les sentiments que vous m’avez inspirés. Je n’eusse pas craint d’en présenter l’hommage à la Divinité même. O vous, qui êtes son plus bel ouvrage, imitez-la dans son indulgence ! Songez à mes peines cruelles ; songez surtout que, placé par vous entre le désespoir et la félicité suprême, le premier mot que vous prononcerez décidera pour jamais de mon sort.
De…, ce 23 août 17**.
Lettre XXXVII. La Présidente de Tourvel à Madame de Volanges
Je me soumets, Madame, aux conseils que votre amitié me donne. Accoutumée à déférer en tout à vos avis, je le suis à croire qu’ils sont toujours fondés en raison. J’avouerai même que M. de Valmont doit être en effet infiniment dangereux, s’il peut à la fois feindre d’être ce qu’il paraît ici, et rester tel que vous le dépeignez. Quoi qu’il en soit, puisque vous l’exigez, je l’éloignerai de moi ; au moins j’y ferai mon possible : car souvent les choses qui dans le fond devraient être les plus simples, deviennent embarrassantes par la forme.
Il me paraît toujours impraticable de faire cette demande à sa tante ; elle deviendrait également désobligeante, et pour elle, et pour lui. Je ne prendrais pas non plus, sans quelque répugnance, le parti de m’éloigner moi-même : car outre les raisons que je vous ai déjà mandées relatives à M. de Tourvel, si mon départ contrariait M. de Valmont, comme il est possible, n’aurait-il pas la facilité de me suivre à Paris ? et son retour, dont je serais, dont au moins je paraîtrais être l’objet, ne semblerait-il pas plus étrange qu’une rencontre à la campagne, chez quelqu’un qu’on sait être sa parente et mon amie ?
Il ne me reste donc d’autre ressource que d’obtenir de lui-même qu’il veuille bien s’éloigner. Je sens que cette proposition est difficile à faire ; cependant, comme il paraît avoir à cœur de me prouver qu’il a en effet plus d’honnêteté qu’on ne lui en suppose, je ne désespère pas de réussir. Je ne serai pas même fâchée de le tenter, et d’avoir une occasion de juger si, comme il le dit souvent, les femmes vraiment honnêtes n’ont jamais eu, n’auront jamais à se plaindre de ses procédés. S’il part, comme je le désire, ce sera en effet par égard pour moi ; car je ne peux pas douter qu’il n’ait le projet de passer ici une grande partie de l’automne. S’il refuse ma demande et s’obstine à rester, je serai toujours à temps de partir moi-même, et je vous le promets.
Voilà, je crois, Madame, tout ce que votre amitié exigeait de moi : je m’empresse d’y satisfaire, et de vous prouver que malgré la chaleur que j’ai pu mettre à défendre M. de Valmont, je n’en suis pas moins disposée, non seulement à écouter, mais même à suivre les conseils de mes amis.
J’ai l’honneur d’être, etc.
De …, ce 25 août 17**.
Lettre XXXVIII. La Marquise de Merteuil au Vicomte de Valmont
Votre énorme paquet m’arrive à l’instant, mon cher Vicomte. Si la date en est exacte, j’aurais dû le recevoir vingt-quatre heures plus tôt. Quoi qu’il en soit, si je prenais le temps de le lire, je n’aurais plus celui d’y répondre. Je préfère de vous en accuser seulement la réception, et nous causerons d’autre chose. Ce n’est pas que j’aie rien à vous dire pour mon compte ; l’automne ne laisse à Paris presque point d’hommes qui aient figure humaine : aussi je suis, depuis un mois, d’une sagesse à périr ; et tout autre que mon Chevalier serait fatigué des preuves de ma constance. Ne pouvant m’occuper, je me distrais avec la petite Volanges ; et c’est d’elle que je veux vous parler.
Savez-vous que vous avez perdu plus que vous ne croyez, à ne pas vous charger de cet enfant ? elle est vraiment délicieuse ! cela n’a ni caractère ni principes ; jugez combien sa société sera douce et facile. Je ne crois pas qu’elle brille jamais par le sentiment ; mais tout annonce en elle les sensations les plus vives. Sans esprit et sans finesse, elle a pourtant une certaine fausseté naturelle, si l’on peut parler ainsi, qui quelquefois m’étonne moi-même, et qui réussira d’autant mieux, que sa figure offre l’image de la candeur et de l’ingénuité. Elle est naturellement très caressante, et je m’en amuse quelquefois : sa petite tête se monte avec une facilité incroyable ; et elle est alors d’autant plus plaisante, qu’elle ne sait rien, absolument rien, de ce qu’elle désire tant de savoir. Il lui en prend des impatiences tout à fait drôles ; elle rit, elle se dépite, elle pleure, et puis elle me prie de l’instruire, avec une bonne foi réellement séduisante. En vérité, je suis presque jalouse de celui à qui ce plaisir est réservé.
Je ne sais si je vous ai mandé que depuis quatre ou cinq jours j’ai l’honneur d’être sa confidente. Vous devinez bien que d’abord j’ai fait la sévère : mais aussitôt que je me suis aperçue qu’elle croyait avoir dû me persuader par ses mauvaises raisons, j’ai eu l’air de les prendre pour bonnes : et elle est intimement persuadée qu’elle doit ce succès à son éloquence : il fallait cette précaution pour ne me pas compromettre. Je lui ai permis d’écrire et de dire j’aime ; et le même jour, sans qu’elle s’en doutât, je lui ai ménagé un tête-à-tête avec son Danceny. Mais figurez-vous qu’il est si sot encore, qu’il n’en a seulement pas obtenu un baiser. Ce garçon fait pourtant de fort jolis vers ! Mon Dieu ! que ces gens d’esprit sont bêtes ! Celui-ci l’est au point qu’il m’en embarrasse ; car enfin, pour lui, je ne peux pas le conduire !
C’est à présent que vous me seriez bien utile. Vous êtes assez lié avec Danceny pour avoir sa confiance, et s’il vous la donnait une fois, nous irions grand train. Dépêchez donc votre Présidente, car enfin je ne veux pas que Gercourt s’en sauve ; au reste, j’ai parlé de lui hier à la petite personne, et je le lui ai si bien peint, que quand elle serait sa femme depuis dix ans, elle ne le haïrait pas davantage. Je l’ai surtout beaucoup prêchée sur la fidélité conjugale. Rien n’égale ma sévérité sur ce point. Par-là, d’une part, je rétablis auprès d’elle ma réputation de vertu, que trop de condescendance pourrait détruire : de l’autre, j’augmente en elle la haine dont je veux gratifier son mari ; et enfin, j’espère qu’en lui faisant accroire qu’il ne lui est permis de se livrer à l’amour que pendant le peu de temps qu’elle a à rester fille, elle se décidera plus vite à n’en rien perdre.