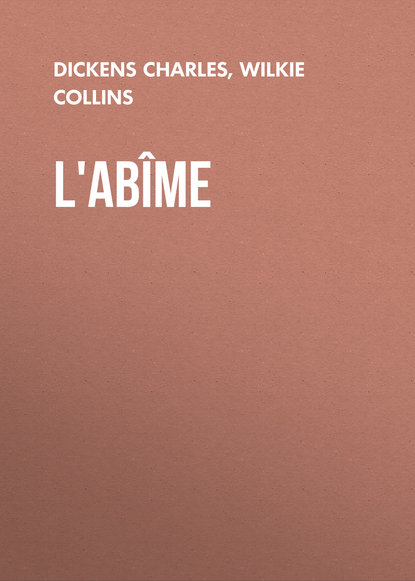 Полная версия
Полная версияПолная версия:
L'abîme
Aussi, le nouvel associé de Wilding et Co., lorsqu'il eut tiré la sonnette, au coin d'une porte où l'on lisait cette inscription:
M. Obenreizeret que cette porte se fut ouverte, se trouva soudain en pleine Helvétie. Un poêle de blanche faïence remplaçait la cheminée dans la pièce où il fut introduit, et le parquet était une mosaïque formée de bois grossiers de toutes les couleurs. La chambre était rustique, froide, et propre. Le petit carré de tapis placé devant le canapé, le dessus en velours de la cheminée avec son énorme pendule et ses vases qui contenaient de gros bouquets de fleurs artificielles contrastaient pourtant un peu avec le reste de l'ameublement. L'aspect général de la chambre était celui d'une laiterie transformée en un salon.
Vendale était là depuis un moment lorsqu'on le toucha au coude. Ce contact le fit tressaillir, il se retourna vivement, et il vit Obenreizer qui le salua en très bon Anglais à peine estropié:
– Comment vous portez-vous? Que je suis content de vous voir!
– Je vous demande pardon, – dit Vendale, – je ne vous avais pas entendu.
– Pas d'excuses, – s'écria le Suisse. – Asseyez-vous, je vous en prie.
Il consentit enfin à lâcher les deux bras de son visiteur qu'il avait jusque-là retenu par les coudes. C'était sa coutume que d'embrasser ainsi les coudes des gens qu'il aimait, et il s'assit à son tour, en disant à Vendale:
– Vous allez bien, j'en suis aise.
En même temps il lui reprit les coudes.
Étrange manie.
– Je ne sais, – dit Vendale, – si vous avez déjà entendu parler de moi par votre maison de Neufchâtel?
– Oui, oui.
– En même temps que de Wilding?
– Certainement.
– N'est-il pas singulier que je vienne aujourd'hui vous trouver dans Londres comme représentant de la maison Wilding et Co., et pour vous présenter mes respects?
– Pourquoi serait-ce singulier? – repartit Obenreizer. – Que vous disais-je toujours autrefois, quand nous étions dans les montagnes? Elles nous paraissaient immenses, mais le monde est petit, si petit qu'on ne peut jamais y vivre longtemps, éloignés les uns des autres. Il y a si peu de monde en ce monde qu'on s'y croise et s'y recroise sans cesse. Le monde est si petit que nous ne pouvons nous débarrasser de ceux qui nous gênent… Ce n'est pas qu'on puisse jamais désirer se débarrasser de vous.
– J'espère que non, Monsieur Obenreizer.
– Je vous en prie, dans votre pays, appelez-moi: Mister. Je ne me fais jamais nommer autrement par amour de l'Angleterre. Ah! que ne suis-je Anglais! Mais, je suis montagnard. Et vous? Bien que descendant d'une famille distinguée, vous avez consenti à vous mettre dans le commerce. Mais, pardon, est-ce que je m'exprime bien? Les vins! cher monsieur, les vins! En Angleterre, est-ce un commerce ou une profession? Sûrement, ce n'est pas un art.
– Monsieur Obenreizer, – reprit Vendale embarrassé, – j'étais un jeune garçon bien neuf, à peine majeur, quand j'ai eu pour la première fois le plaisir de voyager avec vous, et avec mademoiselle votre nièce… qui se porte bien?
– Très-bien!
– Nous courûmes ensemble quelques petits dangers dans les glaciers. Si, à cette époque, avec une vanité d'enfant, je vantai quelque peu ma famille, j'espère ne l'avoir fait qu'autant que cela était nécessaire pour me présenter à vous sous des couleurs plus avantageuses. C'était une petitesse et une chose de mauvais goût. Mais vous n'ignorez pas le proverbe Anglais: «Vivre et s'instruire.»
– Vous attachez bien de l'importance à tout cela, – dit le Suisse. – Que diable! c'est une bonne famille que la vôtre!
Le rire de George Vendale trahit un peu de contrainte.
– J'étais très attaché à mes parents. Cependant, quand nous avons voyagé ensemble, Monsieur Obenreizer, je commençais à jouir de ce que mon père et ma mère m'avaient laissé. J'en avais la tête un peu troublée, parce que j'étais jeune. J'espère donc avoir alors montré plus d'enfantillage et d'étourderie que d'orgueil.
– Rien que de la franchise, de la franchise de cœur et de langage, et point d'orgueil, – s'écria Obenreizer. – Vous employez de trop grands mots contre vous-même. D'ailleurs, c'est moi qui vous ai amené le premier à me parler de votre famille. Vous souvient-il de cette soirée et de cette promenade sur le lac où les pics neigeux venaient se réfléchir comme dans un miroir? Partout des roches et des forêts de sapins qui me ramenaient à mon enfance, dont je vous fis un tableau rapide. Rappelez-vous que je vous peignis notre misérable cahute, près d'une cascade que ma mère montrait aux voyageurs; l'étable où je dormais auprès de la vache; mon frère idiot assis devant la porte et courant aux passants pour leur demander l'aumône; ma sœur, toujours filant et balançant son énorme goitre; et moi-même, une pauvre petite créature affamée, battue du matin au soir. J'étais l'unique enfant du second mariage de mon père, si toutefois il y avait eu mariage. Après cela, quoi de plus naturel de votre part que de comparer vos souvenirs aux miens et de me dire: «Nous sommes du même âge, et en ce même temps où l'on vous battait, moi j'étais assis dans la voiture de mon père, sur les genoux de ma mère chérie, roulant à travers les opulentes rues de Londres, entouré de luxe et de tendresse.» Voilà quel fut le commencement de ma vie.
Obenreizer était un jeune homme aux cheveux noirs, au teint chaud, et dont la peau basanée n'avait jamais brillé d'aucune rougeur, même fugitive. Les émotions qui auraient empourpré la joue d'un autre homme n'amenaient à la sienne qu'un léger battement à peine visible, comme si la machine qui fait couler et monter le sang ne mettait en mouvement dans les veines de ce jeune homme qu'un flot à demi-desséché. Obenreizer était fortement construit, bien proportionné, avec de beaux traits. Il eût certainement suffi d'en changer presque imperceptiblement la disposition pour les amener à une harmonie qui leur manquait; mais il aurait été aussi bien difficile de déterminer au juste quel changement il eût fallu faire. Tout d'abord on aurait souhaité à Obenreizer des lèvres moins épaisses, un cou moins massif. Mais ces lèvres et ce cou passaient encore. Ce qu'il y avait de moins agréable dans son visage, c'étaient ses yeux, toujours couverts d'un nuage indéfinissable évidemment étendu là, par un effort de sa volonté. Son regard demeurait ainsi impénétrable à tout le monde et ce brouillard éternel lui donnait un air fatigant d'attention qui ne s'adressait pas seulement à la personne qu'il écoutait parler, mais au monde entier, à lui-même, à ses propres pensées, celles du moment et celles qui allaient naître. C'était comme une sorte de vigilance inquiète, soupçonneuse, qu'il exerçait en lui, autour de lui, et qui ne se lassait jamais.
À ce moment de la conversation, Obenreizer tira son voile sur ses yeux.
– Le but de ma visite actuelle, – dit Vendale, – il est vraiment superflu de vous le dire, c'est de vous assurer de la bonne amitié de Wilding et Co., et de la solidité de votre crédit sur nous, ainsi que de notre désir de pouvoir vous être utiles. Nous espérons, avant peu, vous offrir une cordiale hospitalité. Pour le moment les choses ne sont pas tout à fait en ordre chez nous. Wilding s'occupe à réorganiser la partie domestique de notre maison; il est, d'ailleurs, empêché par quelques affaires personnelles. Je ne crois pas que vous connaissiez Wilding.
– Je ne le connais pas.
– Il faudra donc faire connaissance. Wilding en sera charmé. Je ne crois pas que vous soyez établi à Londres depuis bien longtemps, Monsieur Obenreizer?
– C'est tout récemment que j'ai installé cette agence.
– Mademoiselle votre nièce n'est-elle… n'est-elle pas mariée?
– Elle n'est pas mariée.
George Vendale jeta un regard autour de lui comme pour y découvrir quelque trace de la présence de la jeune fille.
– Est-ce qu'elle vous a accompagné à Londres? – demanda-t-il.
– Elle est à Londres.
– Quand et où pourrai-je avoir l'honneur de me rappeler à son souvenir?
Obenreizer chassa son nuage et prit de nouveau son visiteur par les coudes.
– Montons! – lui dit-il.
Un peu effarouché par la soudaineté d'une entrevue qu'il avait fortement souhaitée de toute son âme, George Vendale suivit Obenreizer dans l'escalier.
Dans une pièce de l'étage supérieur, une jeune fille était assise auprès de l'une des trois fenêtres; il y avait aussi une autre dame plus âgée, le visage tourné vers le poêle, bien qu'il ne fût pas allumé, car c'était la belle saison. La respectable matrone nettoyait des gants. La jeune fille brodait. Elle avait un luxe inouï de superbes cheveux blonds, gracieusement nattés, le front blanc et rond comme les Suissesses. Son visage était aussi bien plus rond qu'un visage Anglais ordinaire. Sa peau était d'une étonnante pureté et l'éclat de ses beaux yeux bleus rappelait le ciel éblouissant des pays de montagnes. Bien qu'elle fût vêtue à la mode Anglaise, elle portait encore un certain corsage, des bas à coins rouges, et des souliers à boucles d'argent qui venaient de Suisse en droiture. Quant à la vieille dame, les pieds écartés, appuyés sur la tringle du poêle, elle nettoyait, frottait ses gants avec une ardeur extraordinaire, et certainement elle n'avait rien, absolument rien de Britannique. C'était bien la Suisse elle-même, la Suisse vivante, la vieille Suisse: son dos avait la forme et la largeur d'un gros coussin, ses respectables jambes étaient deux montagnes. Elle portait au cou et sur la poitrine un fichu de velours vert qui retenait tant bien que mal les richesses de son embonpoint, de grands pendants d'oreilles en cuivre doré, et sur la tête un voile, en gaze noire, étendu sur un treillis de fer.
– Mademoiselle Marguerite, – dit Obenreizer à sa nièce, – vous rappelez-vous ce gentleman?
– Je crois, – dit-elle en se levant un peu confuse, – je crois que c'est Monsieur Vendale?
– Je crois, en effet, que c'est lui, – fit Obenreizer d'une voix dure. – Permettez-moi, Monsieur Vendale, de vous présenter à Madame Dor.
La vieille dame, qui avait passé un de ses gants dans sa main gauche, se leva, regarda par-dessus ses larges épaules, se laissa retomber sur sa chaise, et se remit à frotter.
– Madame Dor, – dit Obenreizer en souriant, – est assez bonne pour veiller ici aux déchirures et aux taches. Madame Dor vient en aide à mon désordre et à ma négligence, c'est elle qui me tient propre et paré.
Au même instant, Madame Dor, ayant levé les yeux, aperçut une tache sur Obenreizer et se mit à le frotter violemment. George Vendale prit place auprès du métier à broder de Mademoiselle Marguerite; il jeta un regard furtif sur la croix d'or qui plongeait dans le corsage de la jeune fille. Il rendait mentalement à Marguerite l'hommage du pèlerin, lorsqu'après un long voyage, il arrive enfin devant le saint et devant l'autel.
Obenreizer s'assit à son tour au milieu de la chambre, les pouces dans les poches de son gilet; il devenait nuageux, Obenreizer.
– Savez-vous, mademoiselle, ce que votre oncle me disait à l'instant? – commença Vendale: – Que le monde est si petit, si petit, que les anciennes connaissances s'y retrouvent toujours et qu'on ne peut s'éviter. Pour moi, le monde me semblait trop vaste depuis que je vous avais vue pour la dernière fois.
– Avez-vous beaucoup voyagé depuis quelque temps? – lui demanda Marguerite. – Êtes-vous allé bien loin?
– Pas très loin. Je n'ai fait qu'aller chaque année en Suisse… J'ai souhaité bien des fois que ce tout petit monde fût encore plus petit, afin de pouvoir rencontrer plus tôt d'anciens compagnons…
La jolie Marguerite rougit et lança un coup d'œil du côté de Madame Dor.
– Mais vous nous avez retrouvés à la fin, Monsieur Vendale, – murmura-t-elle. – Est-ce pour nous quitter de nouveau?
– Je ne le crois pas. La coïncidence étrange qui m'a permis de vous revoir m'encourage à espérer qu'il n'en sera rien.
– Quelle est cette coïncidence?
Cette simple phrase, dite avec l'accent du pays et certain ton ému et curieux, parut bien séduisante à George Vendale. Mais, au même instant, il surprit un nouveau regard furtif de Marguerite à l'adresse de Madame Dor. Ce regard, bien que rapide comme l'éclair, l'inquiéta, et il se mit à observer la vieille dame.
– Le hasard a voulu, – dit-il, que je devinsse l'associé d'une maison de commerce de Londres, à laquelle Monsieur Obenreizer a été recommandé aujourd'hui même par une maison de commerce Suisse, où nous avons des intérêts communs. Ne vous en a-t-il rien dit?
– Ma foi non! – s'écria Obenreizer, rentrant dans la conversation et cette fois sans son nuage. – Je m'en serais bien gardé. Le monde est si petit, si monotone, qu'il vaut toujours mieux laisser aux gens le plaisir bien rare d'une surprise. C'est une agréable chose qu'une surprise sur notre petit bonhomme de chemin. Tout cela est arrivé comme vous le dit Monsieur Vendale, Mademoiselle Marguerite. Monsieur Vendale, qui est d'une famille si distinguée et d'une si fière origine, n'a point dédaigné le commerce. Vraiment, il fait du commerce, tout comme nous autres, pauvres paysans, sortis des bas-fonds de la pauvreté. Après tout, c'est flatteur pour le commerce, – reprit Obenreizer avec chaleur, – les hommes comme Monsieur Vendale ne peuvent que l'ennoblir. Ce qui fait le malheur du commerce et sa vulgarité, c'est que les gens de rien… nous autres par exemple, pauvres paysans… nous puissions nous y adonner et par lui arriver à tout. Voyez-vous, mon cher Vendale, le père de Mademoiselle Marguerite, l'aîné de mes frères du premier lit, qui aurait plus du double de mon âge s'il vivait, partit de nos montagnes, en haillons, sans souliers, et il se trouva d'abord bien heureux d'être nourri avec les chiens et avec les mules dans une auberge de la vallée. Il y fut garçon d'écurie, garçon de salle, cuisinier. Il me prit alors et me mit en apprentissage chez un fameux horloger, son voisin. Sa femme mourut en mettant Mademoiselle Marguerite au monde. Il ne vécut pas longtemps lui-même. Marguerite n'était plus une enfant et n'était pas encore une demoiselle. Je reçus ses dernières volontés et sa recommandation au sujet de sa fille: «Tout pour Marguerite,» me dit-il, «et tant par an pour vous. Vous êtes jeune, je vous fais pourtant son tuteur; ne vous enorgueillissez jamais de son bien et du vôtre, si vous en amassez. Vous savez d'où nous venons tous les deux; nous avons été l'un et l'autre des paysans obscurs et misérables et vous vous en souviendrez.» Si je m'en souviens!.. Tous deux paysans, et il en est ainsi de tous mes compatriotes qui font aujourd'hui le commerce dans Soho Square. Paysans!.. tous paysans!..
Il éclata de rire, tout en étreignant les coudes de Vendale.
– Voyez! – s'écria-t-il, – voyez quel avantage et quelle gloire pour le commerce d'être rehaussé par des gentlemen tels que vous!
– Je n'en juge pas ainsi, – fit Marguerite en rougissant et fuyant le regard de Vendale avec une expression craintive, – je pense que le commerce n'est point du tout déshonoré par des gens d'obscure origine comme nous…
– Fi! fi! Mademoiselle Marguerite, – dit Obenreizer, – c'est dans l'aristocratique Angleterre que vous tenez un pareil langage!
– Je n'en ai pas honte, – reprit-elle, un peu plus calme et tout en retournant son métier, – je ne suis pas Anglaise, moi. Je me fais gloire d'être Suissesse et fille d'un montagnard. Et certes je le dis bien haut: mon père était paysan.
Il y avait dans ces dernières paroles une résolution si visible d'en finir avec ce sujet ridicule que Vendale n'eut point le courage de se défendre plus longtemps contre les sarcasmes voilés d'Obenreizer.
– Je partage votre opinion, mademoiselle, – s'écria-t-il, – et je l'ai déjà dit à Monsieur Obenreizer, tout à l'heure, il pourra vous en rendre témoignage.
Ce que ce dernier se garda bien de faire. Il se tut.
Vendale n'avait point cessé d'observer Madame Dor. Une chose le frappa dans l'aspect du large dos de la bonne dame, et il remarqua une pantomime des plus expressives dans sa façon de nettoyer les gants. Tandis qu'il causait avec Marguerite, Madame Dor était demeurée tranquille; mais dès qu'Obenreizer eut commencé son long discours sur les paysans, elle se mit à se frotter les mains avec une sorte de délire; on eût dit qu'elle applaudissait l'orateur. Le gant qu'elle tenait s'élevait en l'air, ce gant tournoyait si bien, qu'une fois ou deux, Vendale en vint à penser qu'il pouvait bien y avoir une communication télégraphique dans ce jeu extraordinaire: d'autant que, tout en paraissant ne faire aucune attention à la vieille suivante, Obenreizer ne lui tournait jamais le dos.
La façon dont Marguerite avait écarté le déplaisant sujet qu'on avait ramené deux fois devant elle, parut également à Vendale une chose bien propre à le faire réfléchir. Le ton de la jeune fille, parlant à son tuteur, trahissait une sourde indignation contre celui-ci, et comme un mouvement violent de l'âme, que la crainte pourtant comprimait encore. Jamais Obenreizer ne s'approchait de sa pupille; jamais il ne lui adressait la parole sans faire précéder ce qu'il allait dire d'un «mademoiselle» très cérémonieux, et ce mot pourtant ne sortait jamais de ses lèvres qu'avec un accent d'ironie. L'idée vint à George Vendale que cet homme était un moqueur subtil, et cette nouvelle manière d'envisager Obenreizer lui expliqua tout d'un coup ce qu'il avait toujours trouvé d'indéfinissable en ce singulier personnage.
Quelque chose aussi lui disait que Marguerite était en quelque sorte prisonnière dans ce logis. Sa volonté, du moins, n'était pas libre, et bien qu'elle résistât à ses deux geôliers par la seule énergie de son caractère, certes elle n'était pas toujours la plus forte.
Cette croyance que la jeune fille était persécutée, captive jusqu'à un certain point peut-être, n'était pas faite pour diminuer dans le cœur de Vendale le charme qui l'attirait vers elle. Vraiment il l'aimait, il était éperdument amoureux de la jeune et jolie Suissesse et tout à fait déterminé à saisir l'occasion qui enfin se présenterait à lui.
Pour le moment, il se borna à dépeindre en quelques mots le plaisir que Wilding et Co. auraient avant peu à prier Mademoiselle Obenreizer d'honorer leur maison de sa présence. C'était, disait-il, une vieille maison très curieuse, bien qu'un peu dépourvue comme toute maison de célibataire. Du reste, il ne prolongea pas sa visite.
Mais, en redescendant au rez-de-chaussée, reconduit par son hôte, il trouva dans le vestibule plusieurs hommes de mauvaise mine et mal accoutrés, vêtus d'ailleurs du costume Suisse qu'Obenreizer repoussa sans façon devant lui, tout en leur adressant quelques mots dans le patois du pays.
– Des compatriotes, – dit-il. – de pauvres compatriotes, reconnaissants et attachés comme des chiens pour un peu de bien que je leur fais. Adieu, Monsieur Vendale, j'espère que nous nous verrons souvent. Très enchanté…
Ce qui fut suivi de deux légères pressions aux coudes de Vendale, et celui-ci se trouva dans la rue.
Tandis qu'il se dirigeait vers le Carrefour des Écloppés, Marguerite, assise devant son métier, flottait devant lui dans l'air; il revoyait également le large dos de Madame Dor et son télégraphe. Lorsqu'il arriva, Wilding était enfermé avec Bintrey. Les portes des caves se trouvaient ouvertes. Vendale alluma une chandelle, descendit, et se mit à flâner à travers les caveaux. La gracieuse image de Marguerite marchait toujours devant lui, mais cette fois le dos de Madame Dor ne le poursuivait plus.
Ces voûtes étaient très spacieuses et très anciennes et il y avait là une crypte fort curieuse. C'était, suivant les uns le vieux réfectoire d'un monastère, suivant les autres une chapelle. Quelques antiquaires enthousiastes voulaient même y voir le reste d'un temple Païen. Mais après tout qu'importait? Que chacun donne l'origine qu'il lui plaira à ce vieux pilastre en poussière et à cette arcade en ruine, ce sont toujours des débris du temps qui les ronge également et à sa guise.
L'air épais, l'odeur de terre et de muraille moisie, les pas roulant comme le tonnerre dans les rues qui s'étendaient au-dessus de sa tête, tout cela cadrait assez bien avec les impressions de Vendale qui, décidément, ne pouvait songer qu'à Marguerite, assise là-bas, dans la maison de Soho Square et résistant à ses deux geôliers. Il marcha donc à travers les caves jusqu'au tournant d'un passage voûté. Là, il aperçut une lumière semblable à celle qu'il portait à la main.
– Est-ce vous qui êtes là, Joey? – demanda-t-il.
– Ne devrais-je pas plutôt dire: Est-ce vous, Monsieur George? C'est mon affaire à moi d'être ici; ce n'est pas la vôtre.
– Allons! ne grondez pas, Joey.
– Je ne gronde pas, – fit le garçon de cave, – si quelque chose gronde en moi, c'est le vin que j'ai respiré et pris par les pores, mais ce n'est pas moi. Oh! si vous restiez dans les caves assez longtemps pour que les vapeurs vous étourdissent, vous m'en diriez des nouvelles… Mais quoi! vous voilà donc entré régulièrement dans nos affaires, Monsieur George?
– Régulièrement, j'espère que vous n'y trouvez rien à redire?
– Dieu m'en préserve! Mais le vin que je prends par les pores et qui est grognon me dit que vous êtes trop jeunes. Vous êtes trop jeunes tous les deux.
– C'est un malheur que nous trouverons bien le moyen de réparer quelque jour, Joey.
– Sans doute, Monsieur George, mais moi, qui trouve le moyen de vieillir chaque année, je ne vous verrai point devenir sages.
Et Joey se sentit si content de ce qu'il venait de dire qu'il se mit à rire aux éclats.
– Ce qui est beaucoup moins gai, – reprit-il, – c'est que Monsieur Wilding, depuis qu'il dirige la maison, en a changé la chance. Remarquez bien ce que je vous dis. La chance est changée. Il s'en apercevra. Ce n'est pas pour rien que j'ai passé ici dessous toute ma vie. Les remarques que je fais ne me trompent jamais. Je sais quand il doit pleuvoir ou quand le temps veut se maintenir au beau, quand le vent va souffler, quand le ciel et la rivière redeviendront calmes. Et je sais aussi bien quand la chance est près de changer.
– Est ce que la végétation qui croît sur ces murs est pour quelque chose dans vos observations? – demanda Vendale, en tournant sa lumière vers de sombres amas d'énormes fongus, appendus aux voûtes, et d'un effet désagréable et repoussant.
– Oui, Monsieur George, – répliqua Joey Laddle, reculant de quelques pas. – Mais si vous voulez suivre mon conseil, ne touchez pas à ces vilains champignons.
Vendale avait pris une longue latte des mains de Joey, et s'amusait à remuer doucement les végétaux étranges.
– En vérité, – dit-il, – ne pas y toucher! Et pourquoi?
– Pourquoi?.. Parce qu'ils naissent des vapeurs du vin, et qu'ils peuvent tous faire comprendre ce qui entre dans le corps d'un malheureux garçon de cave qui vit ici depuis trente ans; parce que vous feriez tomber sur vous de sales insectes, qui se meuvent dans ces gros pâtés de moisissure, – répliqua Joey Laddle, qui se tenait toujours à l'écart, – mais il y a encore une autre raison, Monsieur George: il y en a une autre!..
– Laquelle?
– À votre place, Monsieur George, je ne jouerais pas avec cette latte. Et la raison, je vous la dirai si vous voulez sortir d'ici. Regardez la couleur de ces champignons, Monsieur George.
– Eh bien?
– Allons! Monsieur George, sortons d'ici.
Il s'éloigna avec sa chandelle. Vendale le suivit tenant la sienne.
– Mais achevez donc, Joey, – dit-il. – La couleur de ces champignons?
– C'est celle du sang, Monsieur George.
– En vérité, oui… Après?..
– Eh bien! Monsieur George, on dit…
– Qui… on?
– Comment saurais-je qui? – répliqua le vieux garçon de cave exaspéré par la nature déraisonnable de cette question. – Qui?.. On… on… Cela en dit bien assez. C'est tout le monde. Comment saurais-je qui est cet: On, si vous, vous ne le savez pas?
– C'est juste, Joey.
– On dit que l'homme qui, par hasard, est frappé à la poitrine dans les caves d'un de ces champignons qui tombent, est sûr de mourir assassiné.
Vendale s'arrêta en riant, il regarda Joey et leva les épaules, mais le garçon de cave tenait ses yeux obstinément fixés sur sa chandelle. Tout à coup Joey se sentit frappé violemment.
– Qu'est-ce? – cria-t-il.
C'était la main de son compagnon. Vendale venait de recevoir un énorme amas de ces moisissures sanglantes en pleine poitrine, et instinctivement l'avait rejeté sur Joey. Cette masse, humide venait de s'abattre sur le sol et y faisait couler une longue mare rouge.
Les deux hommes se regardèrent, pendant un moment, avec une muette épouvante. Mais ils arrivaient au pied de l'escalier des caves, et la lumière du jour leur apparut.



