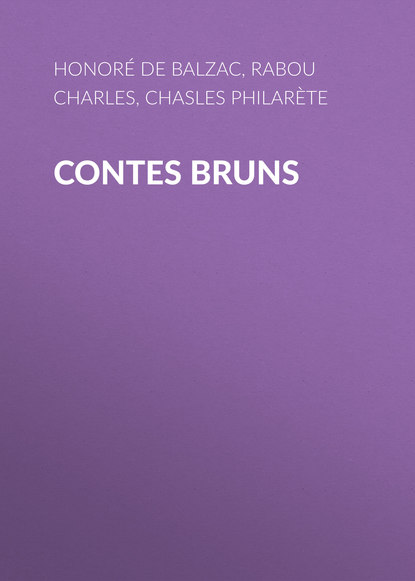 Полная версия
Полная версияContes bruns
– Mon pauvre ami, qui donc maintenant te comprendra?..
Puis elle mourut en le regardant.
– Les histoires que conte le docteur, reprit une dame après un moment de silence, me font des impressions bien profondes.
Le médecin salua gravement.
– Oui, elles sont douces et intéressantes; il nous émeut sans employer les atrocités si fort à la mode aujourd'hui…
– Ma réserve, dit-il, n'est certes pas de l'impuissance, et je vous prie de croire, madame, que j'ai ma provision d'horrible tout comme un autre.
– Eh bien! s'écria la maîtresse de la maison, racontez-nous un peu quelque chose d'affreux. Je voudrais voir la couleur de votre tragique, quand ce ne serait que pour le comparer avec celui qui a présentement cours à la bourse littéraire.
– Malheureusement, madame, je ne parle que de ce que j'ai vu.
– Eh bien!
– Mais je dois avoir le dessous avec les gens qui ont sur moi tous les avantages que donne l'imagination. Je ne puis pas vous mettre en scène deux frères nageant en pleine mer et se disputant une planche… ou un homme qui a entrepris de manger un régiment à la croque-au-sel. Je ne puis être que vrai.
– Eh bien! nous nous contenterons de la vérité.
– Je ne veux pas me faire prier, reprit-il, et il se moucha.
– Le hasard, dit-il, me mit autrefois en relation avec un homme qui avait roulé dans les années de Napoléon, et dont alors la position était assez brillante pour un militaire de son grade. Il était capitaine, et occupait à l'état-major de Paris, je crois, une place qui lui valait de quatre à cinq mille francs; en outre il possédait quelque fortune. Où l'avait-il prise, je ne sais. Il était de basse extraction, et pour n'avoir pas d'avancement sous l'empire, il fallait être un traînard, un niais, un ignorant ou un lâche. Cependant il y a aussi des gens malheureux. Mon homme n'était rien de tout cela; c'était le type des mauvais soudards, débauché, buveur, fumeur, vantard, plein d'amour-propre, voulant primer partout, ne trouvant d'inférieurs que dans la mauvaise compagnie et s'y plaisant, racontant ses exploits à tous ceux qui ne savaient pas si une demi-lune est quelquefois entière, enfin un vrai chenapan, comme il s'en est tant rencontré dans les armées; ne croyant ni à Dieu ni au diable; bref pour achever de vous le peindre, il suffira de vous dire ce qui m'arriva un jour que je l'avais rencontré du côté de la Bastille. Nous allions l'un et l'autre au Palais-Royal. Nous cheminâmes par les boulevards. Au premier estaminet qui se trouva:
– Permettez-moi, dit-il, d'entrer là un petit moment; j'ai un restant de tabac à y prendre et un verre d'eau-de-vie.
Il avala le petit verre d'eau-de-vie, et reprit en effet une pipe chargée et un peu de tabac à lui.
Au second estaminet il avait achevé de fumer son restant de tabac, et recommença son antienne. Ce diable d'homme avait des restans de tabac dans tous les estaminets, et c'étaient comme autant de relais pour des pipes et son gosier. Il avait établi dans Paris ses lignes de communication. Je ne vous parlerai pas de ses moustaches grises, de ses vêtemens caractéristiques, de son idiome et de ses tics, ce serait vous en entretenir jusqu'à demain. Je crois qu'il ne s'était jamais peigné les cheveux qu'avec les cinq doigts de la main. J'ai toujours vu à son col de chemise la même teinte blonde. Eh bien! cet homme-là, ce chenapan, avait une assez belle figure, figure militaire, de grands traits, une expression de calme; mais j'ai toujours cru lire au fond de ses yeux verts de mer et tachetés de points orangés quelques-unes de ces aventures où il y a de la fange et du sang. Ses mains ressemblaient à des éclanches. Il était d'une taille médiocre, mais large des épaules et de la poitrine, un vrai corsaire. Par-dessus tout cela il se disait un des vainqueurs de la Bastille. Cet homme rencontra une jeune fille assez folle pour s'amouracher de lui. C'était une grisette, mais un amour de feu. Elle avait nom Clarisse, et travaillait chez une fleuriste. Elle avait tout joli, la taille, les pieds, les cheveux, les mains, les formes, les manières. Son teint était blanc, sa peau satinée. Il n'y a vraiment qu'à Paris que se trouvent ces espèces de produits et ces sortes de passions. Jamais je n'ai vu de contraste aussi tranché que l'opposition présentée par ce singulier couple. Clarisse était toujours mignonne, propre et bien mise. Par amour-propre, le capitaine lui donnait tout ce qu'elle lui demandait, et la pauvre enfant lui demandait peu de choses: c'étaient la partie de spectacle, quelques robes, des bijoux. Jamais elle ne voulut être épousée, et s'il la logea, s'il meubla son appartement, ce fut par vanité. Cette jeune fille était le dévouement même. J'ai souvent pensé que ces pauvres créatures obéissent à je ne sais quelle charitable mission en se donnant à ces hommes si rebutans, si rebutés, aux mauvais sujets. Il y a dans ces actes du coeur un phénomène qu'il serait intéressant d'analyser.
Clarisse tomba malade, elle eut une fièvre putride, à laquelle se mêlèrent de graves accidens, et le cerveau fut entrepris. Le capitaine vint me chercher; je trouvai Clarisse en danger de mort, et, prenant son protecteur à part, je lui fis part de mes craintes.
– Il faut, lui dis-je, avoir une bonne garde-malade au plus tôt; car cette nuit sera très-critique.
En effet, j'avais ordonné de mettre à une certaine heure des sinapismes aux pieds, puis d'appliquer, une demi-heure après l'effet du topique, de la glace sur la tête, et lorsqu'elle serait fondue, de placer un cataplasme sur l'estomac… Il y avait d'autres prescriptions dont je ne me souviens plus.
– Oh! me répondit-il, je ne me fierais point à une garde; elles dorment, elles font les cent coups, tourmentent les malades. Je veillerai moi-même, et j'exécuterai vos ordonnances comme si c'était une consigne.
A huit heures du matin, je revins, fort inquiet de Clarisse; mais en ouvrant la porte, je fus suffoqué par les nuages de fumée de tabac qui s'exhalèrent, et au milieu de cette atmosphère brumeuse, je vis à peine, à la lueur de deux chandelles, mon homme fumant sa pipe et achevant un énorme bol de punch. Non, je n'oublierai jamais ce spectacle. Auprès de lui Clarisse râlait et se tordait; il la regardait tranquillement. Il avait consciencieusement appliqué les sinapismes, la glace, les cataplasmes; mais aussi le misérable, en faisant son office de garde-malade, trouvant Clarisse admirablement belle dans l'agonie, avait sans doute voulu lui dire adieu; du moins le désordre du lit me fit comprendre les événemens de la nuit. Je m'enfuis, saisi d'horreur: Clarisse mourait.
– L'horrible vrai est toujours plus horrible encore!.. dit le sculpteur.
– Il y a de quoi frémir quand on songe aux malheurs, aux crimes qui sont commis à l'armée, à la suite des batailles, quand la méchanceté de tant de caractères méchans peut se déployer impunément!.. reprit une dame.
– Oh! dit un officier qui n'avait pas encore parlé de la soirée, les scènes de la vie militaire pourraient fournir des milliers de drames. Pour ma part, je connais cent aventures plus curieuses les unes que les autres; mais en m'en tenant à ce qui m'est personnel, voici ce qui m'est arrivé…
Il se leva, se mit devant nous, au milieu de la cheminée, et commença ainsi:
– C'était vers la fin d'octobre; mais non, ma foi, c'était bien dans les premiers jours de novembre 1809, je fus détaché d'un corps d'armée qui revenait en France, pour aller dans les gorges du Tyrol bavarois. En ce moment nous avions à soumettre, pour le compte du roi de Bavière, notre allié, cette partie de ses états que l'Autriche avait réussi à révolutionner. Le général Chatler s'avançait même avec un ou deux régimens allemands, dans le dessein d'appuyer les insurgés, qui étaient tous gens de la campagne.
Cette petite expédition avait été confiée par l'empereur à un certain général d'infanterie nommé Rusca, qui se trouvait alors à Clagenfurth, à la tête d'une avant-garde d'environ quatre mille hommes. Comme Rusca était sans artillerie, le maréchal Marmont… avait donné l'ordre de lui envoyer une batterie, et je fus désigné pour la commander.
C'était la première fois, depuis ma promotion au grade de lieutenant, que je me voyais, au milieu d'une brigade, le seul officier de mon corps, ayant à conduire des hommes qui n'obéissaient qu'à moi, et obligé de m'entendre, comme chef d'une arme, avec un officier général.
– C'est bon, me dis-je en moi-même, il y a un commencement à tout, et c'est comme cela qu'on devient général.
– Vous allez avec Rusca?.. me dit mon capitaine, prenez garde à vous, c'est un malin singe, un vaurien fini. Son plus grand plaisir est de mettre dedans tous ceux qui ont affaire à lui. Pour vous apprendre ce que c'est que ce chrétien-là, il suffira peut-être de vous dire qu'il s'est amusé dernièrement à baptiser du vin blanc avec de l'eau-de-vie, afin de renvoyer à l'empereur un aide-de-camp soûl comme une grive… Si vous vous comportez de manière à éviter ses algarades, vous vous en ferez un ennemi mortel… Voilà le pèlerin… Ainsi, attention!
– Hé bien, répliquai-je à mon capitaine, nous nous amuserons; car il ne sera pas dit qu'un pousse-cailloux embêtera un officier d'artillerie.
Dans ce temps-là, voyez-vous, l'artillerie était quelque chose, parce que le corps avait fourni l'empereur…
Me voilà donc parti, moi et mes canonniers, et nous gagnons Clagenfurth. J'arrive le soir; et, aussitôt que mes hommes sont gîtés, je me mets en grande tenue et je me rends chez le Rusca. Point de Rusca.
– Où est le général, demandais-je à une manière d'aide-de-camp qui baragouinait un français mêlé d'italien.
– Le zénéral est à la zouziété, dans oun chercle, au café, à boire de la bière sou la piazza.
Je regarde mon homme en face, et je m'aperçois qu'il n'est pas ivre comme ses incohérences me le faisaient supposer.
– Vous êtes étonné… reprit l'aide-de-camp. Ma s'il est là de si bonne houre, c'est pour oune petite difficoulté quél zénéral il a ou avec les habitanti. Par ché i son di oumor pauco contrariente les Tedesques. Ces chiens-là né se sont-ils pas avisés dé né piou audare boire de la bière all chercle per ché lè zénéral y était…
En ce moment, nous fûmes interrompus par un roulement de tambour, après quoi le crieur de la ville lut en français d'abord, puis en allemand et en italien, une proclamation de Rusca, en vertu de laquelle il était enjoint à tous les négocians et notables habitans de Clagenfurth d'aller, comme par le passé, au cercle, pendant toutes les soirées, sous peine d'être taxés à un contribution extraordinaire.
– Et comment le paieront-ils donc?.. dit le colonel du 20e qui se trouvait auprès de moi, car je m'étais avancé pour écouter; ce serait la quatrième qu'il lèverait sur ces pauvres diables. Ce compère-là est capable de les faire révolter, pour se donner le plaisir de mitrailler une sédition populaire…
– Pourquoi n'allaient-ils plus au café?.. mon colonel, lui demandais-je.
Le colonel me regarda.
– Vous arrivez… à ce que je vois, me répondit-il. Eh bien! voilà le fait. Ce diable de Rusca ne s'amusait-il pas, le soir, à allumer sa pipe, au cercle, devant ces pauvres gens, avec les billets de florins qu'il leur arrachait le matin!.. Il faut que ce soit encore un bien bon peuple, ces Allemands, pour qu'aucun d'eux ne lui ait tiré un coup de pistolet… Heureusement, nous partirons demain; nous n'attendions que vous…
– Il paraît, lui dis-je, que votre général n'est pas commode?..
– C'est un excellent militaire… répliqua-t-il, et il entend particulièrement la guerre que nous allons faire. Il a été médecin dans la partie de l'Italie qui avoisine les montagnes du Tyrol, et il en connaît les routes, les sentiers, les habitans. Il est d'une bravoure exemplaire; mais c'est bien le plus malicieux animal que j'aie jamais connu. S'il ne brûle pas les paysans dans leurs villages, il faudra qu'il soit dans ses bons jours…
Le colonel s'éloigna en voyant un officier venir à nous.
Je fus assez embarrassé de ma personne en me trouvant seul. Je pensai qu'il n'était pas convenable que j'allasse voir Rusca au cercle; et, alors, je revins à l'aide-de-camp, qui était toujours resté immobile sur le seuil de la porte, occupé à fumer son cigare. J'avais toujours rencontré son regard, quand je jetais par hasard les yeux sur lui en causant avec le colonel; et, quoique ce regard me parût aussi railleur que perfide, je le priai d'annoncer à son général ma visite pour la fin de la soirée, objectant la nécessité dans laquelle j'étais de prendre quelque chose; car je n'avais rien mangé depuis le matin… mais un officier n'est pas aussi heureux que la mule du pape; en campagne, il n'a pas d'heures pour ses repas; il se nourrit comme il peut, et quelquefois pas du tout. Au moment où j'allais retourner à mon logement, j'entendis une grande rumeur dans le faubourg par lequel j'étais entré. Je demande à un soldat qui me parut en venir la raison de ce tumulte, et il me dit que l'un de mes canonniers en était cause; alors je fus forcé de me rendre sur les lieux pour savoir ce qui se passait. Il y avait des attroupemens composés de femmes principalement, qui paraissaient en colère, criaient et parlaient toutes ensemble; c'était comme dans une basse-cour, quand les poules se mettent à piailler. Au milieu du faubourg, je vis une grande et belle fille autour de laquelle on s'attroupait; quand elle m'aperçut, elle fendit la presse et vint à moi. Elle était furieuse, elle parlait avec une volubilité convulsive; elle avait des couleurs, les bras nus, la gorge haletante, les cheveux en désordre, les yeux enflammés, la peau mate; elle gesticulait avec feu, elle était superbe; c'est une des plus belles colères que j'ai vues dans ma vie. Là, je sus la cause de cette émeute. Mon fourrier était logé chez le père de cette fille; et il paraît que, la trouvant à son goût, il avait voulu la cajoler; mais qu'elle s'était brutalement défendue; alors mon diable de canonnier, un provençal, il se nommait Lobbé, c'était un petit homme, à cheveux noirs, bien frisés, qu'on avait appelé dans la compagnie la Perruque. La Perruque donc, par vengeance, se faisait servir par le père et la mère de cette fille; et, comme il était assis sur un fauteuil très-élevé, il avait mis chacun de ses pieds sur un escabeau de chaque côté de la table, et, pendant son repas, il avait forcé la mère et le père, qui était un homme à cheveux blancs, de tourner les étoiles de ses éperons. Il dînait gravement, ayant à ses pieds les deux vieillards agenouillés, occupés à faire aller les molettes. Cette fille, ne pouvant pas digérer cet affront, essayait d'ameuter le quartier contre les Français.
Lorsque j'eus compris le sujet de ses plaintes, je m'empressai d'aller au logement de la Perruque, et je le vis en effet assis comme un pacha, regardant les deux vieillards, bons Allemands, qui faisaient consciencieusement aller les éperons. Je n'oublierai jamais le geste de la fille quand, en entrant avec moi, elle me montra ses parens. Elle avait les larmes aux yeux, et me dit d'un son de voix guttural en allemand:
– Sieht!.. Voyez!..
– Allons donc, Lobbé, finissez, dis-je à mon canonnier. Que diable, vous mériteriez d'être puni… Cela ne se fait pas…
Les deux vieillards continuaient toujours.
– Mais, mon lieutenant, me dit la Perruque, tenez, regardez-les!.. Ça ne les contrarie pas… ça les amuse.
Je faillis rire.
En ce moment, un gros homme bourgeonné, la face rouge et le nez bulbeux, entra. A l'uniforme, je reconnus le général Rusca.
– Bien, bien, canonnier!.. s'écria-t-il. Voilà dix florins pour t'encourager à établir la domination française sur ces chiens-là…
Et il lui jeta des florins.
– Il me semble, mon général, lui dis-je avec fermeté, quand nous sortîmes, que si vous m'avez entendu, la discipline militaire est compromise. Il m'est fort indifférent, si cela vous plaît, que mon fourrier fasse tourner ses molettes, mais puisque je lui avais ordonné de cesser, et qu'il est sous mes ordres…
– Ah! dit-il en m'interrompant, tu es sorti de cette école où l'on raisonne?.. Je vais t'apprendre à clocher avec les boiteux…
– Quels sont vos ordres, lui demandais-je?
– Viens les prendre ce soir à huit heures!..
Et nous nous quittâmes. Ce commencement de relations ne promettait rien de bon.
A huit heures, après avoir dîné, je me présentai chez le général que je trouvai buvant et fumant en compagnie de son aide-de-camp, du colonel et d'un Allemand qui paraissait être un personnage de Clagenfurth. Rusca me reçut civilement, mais il y avait toujours une teinte d'ironie dans son discours. Il m'invita fort courtoisement à boire et à fumer; je ne bus guère que deux verres de punch et fumai trois cigares.
– Demain nous partirons à sept heures, et devrons être en vue de Brixen dans la journée, il faut entamer ces gens-là vivement.
Je me retirai. Le lendemain, je crus m'éveiller à six heures, il était neuf heures passées. Rusca m'avait sans doute mis quelque drogue dans mon verre, et je fus au désespoir en apprenant qu'il s'était mis en bataille à six heures du matin, et qu'il avait trois heures de marche en avance. Mon hôte, comprenant que j'en voulais à Rusca, me proposa de me donner les moyens d'arriver à Brixen avant lui. La tentative était audacieuse, car il fallait m'embarquer dans des chemins de traverse où je pouvais rester; mais, jeune et dépité comme je l'étais, je fis mon va-tout. Cependant je ne voulus rien négliger: je communiquai mon entreprise à mes sous-officiers, qui crurent leur honneur aussi bien engagé que le mien, nous mêlâmes du vin à l'avoine de nos chevaux, et les bons Allemands, apprenant que nous voulions jouer un tour au Rusca, nous fournirent quatre guides chargés de nous préserver de tout malheur. Effectivement, Rusca nous trouva reposés et en bataille en avant de Brixen, l'attendant avec insouciance.
– Comment, messieurs les b… vous êtes partis avant nous?.. dit le général. Vous me paierez cela, lieutenant… ajouta-t-il en me regardant.
– Mon général, lui dis-je, vous ne m'avez pas ordonné de vous accompagner; si vous vous en souvenez, votre ordre a été de regarder Brixen comme le point de notre ralliement. Il ne souffla pas mot; mais je vis qu'il faudrait jouer serré avec ce vieux singe-là. Nous entrâmes en campagne au-delà de Brixen, j'avoue que je n'avais jamais vu faire la guerre ainsi. Nous battions la campagne en visitant tous les villages, les chemins, les champs. Vous eussiez dit une chasse, les soldats rabattaient les paysans comme du gibier sur la principale route suivie par le général, et quand il s'en trouvait en quantité suffisante, Rusca passait tous ces malheureux en revue, en leur ordonnant de tendre leur main gauche; puis, au seul aspect de la paume de cette main, il faisait signe, remuant la tête, d'en séparer certains des autres, et il laissait le reste libre de retourner à leurs affaires: puis aussitôt, sans autre forme de procès, il fusillait ceux qu'il avait ainsi triés. La première fois que j'assistai à cette singulière enquête, je priai Rusca de m'expliquer ce mode de procéder. Alors, à quelques pas de l'endroit où nous étions, il aperçut dans un buisson je ne sais quels vestiges, et il le fit cerner. Le buisson fouillé, les soldats trouvèrent dans une espèce de trou deux hommes armés de carabines, qui attendaient sans doute que nous fussions passés afin de tuer nos traînards. Avant de les faire fusiller, Rusca me montra leurs mains gauches. Dans ce pays, les chasseurs ont l'habitude de verser la poudre nécessaire pour la charge de leurs carabines dans le creux de leurs mains, et la poudre y laisse une empreinte assez difficile à distinguer, mais que l'oeil de Rusca savait y voir avec une grande dextérité. Dès l'enfance, il avait observé ce singulier diagnostic, et il lui suffisait de voir les mains des paysans pour deviner s'ils avaient récemment fait le coup de fusil. Le second jour, nous rencontrâmes un vieillard, septuagénaire au moins, perché sur un arbre et occupé à l'émonder. Rusca le fit descendre et lui examina la main gauche; par malheur, il crut y apercevoir le signe fatal, et, quoique le pauvre homme parût bien innocent, il ordonna de l'attacher à l'affût d'un canon. Ce malheureux fut obligé de suivre, et nous allions au petit trot. De temps en temps il gémissait; les cordes lui enflaient les mains; il se trouva bientôt dans un état pitoyable; ses pieds saignaient; il avait perdu ses sabots, et j'ai vu tomber de grosses larmes de sang de ses yeux. Nos canonniers, qui avaient commencé par rire, en eurent compassion, et vraiment il y avait de quoi, à voir ce vieillard en cheveux blancs, traîné pendant les dernières lieues comme un cheval mort. On finit par le jeter sur le canon, et comme il ne pouvait pas parler, il remercia les soldats par un regard à tirer des larmes. Le soir, lorsque nous bivouaquâmes, je demandai à Rusca ses ordres relativement à ce vieillard.
– Fusillez-le… me dit-il.
– Mon général, répondis-je, vous êtes le maître de sa vie; mais si je commande à mes canonniers de tuer cet homme, ils me diront que ce n'est pas leur métier…
– C'est bon!.. répliqua-t-il en m'interrompant. Gardez-le jusqu'à demain matin, et nous verrons…
– Je ne me refuserai pas à le garder, dis-je; mais je ne veux pas en répondre.
Et je sortis de la maison où était Rusca, sans entendre sa réplique; mais je sus plus tard qu'il m'avait cruellement menacé…
En ce moment je partis, malgré tout l'intérêt que promettait ce début. La pendule marquait minuit et demi. J'étais près de Saint-Germain-des-Prés et je demeure à l'Observatoire. – Un jour j'aurai la suite de Rusca; le nom me fait pressentir quelque drame; car je partage, relativement aux noms, la superstition de M. Gautier Shaudy. Je n'aimerais certes pas une demoiselle qui s'appellerait Pétronille ou Sacontala, fût-elle jolie…
– Ma femme se nomme Rose-Vertu… me dit l'officier de l'Université qui faisait route avec moi.
– Je le crois bien!.. répliquai-je; Mlle Mars a nom Hippolyte… Et vous, monsieur? lui demandai-je.
– Moi!.. Sébastien!..
– C'est un martyr… et vous êtes sans doute très-heureux en ménage?
– Mais oui… Nous étions arrivés.
Ce fragment de conversation est sincère et véritable. Je puis affirmer que, sauf de légères inexactitudes, bien pardonnables, et qui n'ont adultéré ni le sens ni la pensée, tout ceci a été dit par des hommes d'un haut mérite. N'est-ce pas un problème intéressant à résoudre pour l'art en lui-même, que de savoir si la nature, textuellement copiée, est belle en elle-même? Nous avons tous été fortement émus, un lecteur le sera-t-il?.. Nous allons voir la Marguerite de Scheffer; et nous ne faisons pas attention à des créatures qui fourmillent dans les rues de Paris, bien autrement poétiques, belles de misère, belles d'expression, sublimes créations, mais en guenilles… Aujourd'hui nous hésitons entre l'idéalisation et la traduction littérale des faits, des hommes, des événemens. Choisissez… Voici une aventure où l'art essaie de jouer le naturel.
L'OEIL SANS PAUPIÈRE
Hallowe'en, Hallowe'en! criaient-ils tous, c'est ce soir la nuit sainte, la belle nuit des skelpies1 et des fairies2! Carrick! et toi, Colean, venez-vous? Tous les paysans de Carrick-Border3 sont là, nos Megs et nos Jeannies y viendront aussi. Nous apporterons de bon whiskey dans des brocs d'étain, de l'ale fumeuse, le parritch4 savoureux. Le temps est beau; la lune doit briller; camarades, les ruines de Cassilis-Downaus n'auront jamais vu d'assemblée plus joyeuse!»
Ainsi parlait Jock Muirlaud, fermier, veuf et jeune encore. Il était, comme la plupart des paysans d'Écosse, théologien, un peu poète, grand buveur, et cependant fort économe. Murdock, Will Lapraik, Tom Duckat, l'entouraient. La conversation avait lieu près du village de Cassilis.
Vous ne savez sans doute pas ce que c'est que l'Hallowe'en: c'est la nuit des fées; elle a lieu vers le milieu d'août. Alors on va consulter le sorcier du village; alors tous les esprits follets dansent sur les bruyères, traversent les champs, à cheval sur les pâles rayons de la lune. C'est le carnaval des génies et des gnomes. Alors il n'y a pas de grotte ni de rocher qui n'ait son bal et sa fête, pas de fleur qui ne tressaille sous le souffle d'une sylphide, pas de ménagère qui ne ferme soigneusement sa porte, de peur que le spunkie5 n'enlève le déjeuner du lendemain, et ne sacrifie à ses espiègleries le repas des enfans qui dorment enlacés dans le même berceau.
Telle était la nuit solennelle, mêlée de caprice fantastique et d'une secrète terreur, qui allait s'élever sur les collines de Cassilis. Imaginez un terrain montagneux, qui ondule comme une mer, et dont les nombreuses collines se tapissent d'une mousse verte et brillante; au loin, sur un pic escarpé, les murs crénelés du château détruit, dont la chapelle, privée de sa toiture, s'est conservée presque intacte, et fait jaillir dans l'éther pur ses pilastres minces, sveltes comme des branchages en hiver et dépouillés de leur feuillage. La terre est inféconde dans ce canton. Le genêt doré y sert de retraite au lièvre; la roche paraît à nu de distance à distance. L'homme qui ne reconnaît un pouvoir suprême que dans la désolation et la terreur regarde ces terrains stériles comme frappés du sceau même de la Divinité. La bienfaisance féconde et immense du Très-Haut nous inspire peu de gratitude: c'est son châtiment et sa rigueur que nous adorons.

