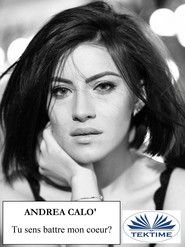скачать книгу бесплатно
Tu Sens Battre Mon Coeur ?
Andrea Calo'
Andrea Calò
.
TU SENS BATTRE MON COEUR?
.
Première édition – Mai 2014
.
.
Ce roman est basé sur une histoire vraie. Les noms des personnages, les lieux et certaines situations ont été modifiés par l’auteur pour garantir la vie privée des protagonistes. Toute autre ressemblance avec des faits, des évènements, des lieux et des personnes, existant ou ayant existé, est purement fortuite.
.
.
© Copyright 2014 – Andrea Calò
.
Traduit par Pascale Leblon
.
Couverture: Nicoleta Nuca (avec son aimable autorisation)
À mon épouse Sonia,
l’amour de ma vie.
Pour toujours.
1.
Quand le dernier des amis quitta notre maison après m’avoir saluée, je fermai la porte à clé. Je restais seule, et ce n’était pas qu’une solitude physique. J’avais froid et même me couvrir d’un pull en laine n’avait pas amélioré la situation. Mon cœur battait lentement dans ma poitrine. Un battement sourd et profond, suivi d’un long silence qui présageait la mort, déçue par le tardif battement suivant. J’étais en vie. J’avais froid, donc je vivais. Le soleil de mai avait chassé les journées glaciales de l’hiver depuis plusieurs jours. Pourquoi ça n’avait pas le même effet sur moi ? Je regardai dehors, par la fenêtre. Les cerisiers étaient blancs de fleurs, qui deviendraient bientôt des fruits rouges et sucrés. Certaines avaient déjà cédé leur place, se détachant des branches pour se poser au sol ou sur les épaules des passants, comme une neige cotonneuse. C’étaient des fleurs sans avenir ou des fruits sans passé, exactement comme moi. Mais ces fleurs cueillies par la mort portée par un souffle de vent chassaient la grisaille du ciment et de l’asphalte, leur donnant vie. Moi au contraire, je me laisserais juste pourrir sous terre, immobile pour l’éternité, contrainte à regarder pousser les racines des marguerites. Ou je me ferais incinérer et mettre dans une urne froide, comme celle de mon mari, pour voir si l’enfer existe vraiment et découvrir ce que ça fait d’y brûler. Enterrée ou brûlée, je devais encore décider de la façon dont je serais oubliée. Oubliée de mes enfants, du monde entier et de moi-même. Certaine que rien ne s’arrêterait après mon départ pour l’éternité. Je me tournai pour regarder l’urne, je ne l’avais pas encore fait depuis la fin de la cérémonie. Elle était grise, un gris foncé comme ce “fumée de Londres” qu’il aimait tant et qu’il choisissait chaque fois que nous allions acheter des vêtements. Sur mon insistance, il me faisait plaisir en essayant d’autres couleurs, un peu plus vives. Mais à la fin de ce petit jeu, les articles choisis et déposés sur le comptoir de la caisse étaient toujours les mêmes. « Je dois me sentir bien dedans, aussi longtemps que je les porterai », me disait-il chaque fois. Il se tournait ensuite vers la caissière et, lui causant un grand embarras, lui demandait : « Et vous, mademoiselle, qu’en pensez-vous ? » Et voilà mon choix encore une fois dicté par sa considérable mais imperceptible présence. Comme la caissière, j’avais assuré que le gris était fait pour lui. J’avais payé et m’étais enfuie, la lourde marchandise serrée dans mes mains fatiguées. Une urne grise, “fumée de Londres”, son éternel dernier costume, celui qu’il n’enlèverait plus jamais. Je m’approchai et la caressai. Je la soulevai et pus sentir le poids de sa vie dans mes bras. Le froid piquant du métal gagnait du terrain sous ma main affaiblie. Je percevais une chaleur subtile dans mon bras, une chaleur qui montait dans mon corps, l’enveloppant tout entier, et faisait accélérer mon cœur. Je ne comprenais pas si c’était plutôt un désagrément ou du pur bien-être. Je vivais plus, je vivais mieux. Mais je vivais ! J’ôtai ma main, et voilà que revenait le vide qui frappait à ma porte. Ma main se réchauffait, mon bras se refroidissait, mon cœur ralentissait. Je reprenais lentement ma course vers la mort. Mais je savais qu’elle ne s’arrêterait pas tout de suite. Il n’y aurait pas de remise sur la souffrance de cet abandon car la vie n’offre jamais de “soldes de fin de saison”. Le cercle se refermait sur lui-même et le cycle recommençait au début. Je versai de l’eau dans la bouilloire et l’allumai. Je restai immobile quelques minutes, le regard fixé sur la diode rouge en attendant qu’elle s’éteigne toute seule. Elle aussi mourait à sa façon, comme tout, comme tous, comme toujours. Mais elle pouvait revivre, renaître, si on lui insufflait la vie de l’extérieur. Tout comme ça m’était arrivé cinquante ans auparavant. J’avais regardé mon compagnon de la même façon durant ses derniers instants, mes yeux fixés sur les siens, écarquillés et immobiles mais encore capables de briller d’une lumière propre, comme la diode de la bouilloire, dans ce silence lourd que seule une vie qui quitte un corps peut provoquer. Un branle-bas de pensées désordonnées, d’images heureuses surgit dans une mer de larmes. Et sous le plateau qui portait mon bonheur, il y avait lui. L’homme qui sortait de l’eau comme un dieu grec, puissant de simplicité, terrifiant de douceur. Et moi, assise sur ce plateau, je festoyais avec mon bonheur jusqu’à satiété, et plus je mangeais et plus je me sentais légère, capable de m’envoler d’un simple saut.
Je mis dans une tasse quelques feuilles de thé vert, agrémentées de feuilles de menthe congelées, pour qu’elles restent fraîches et parfumées. Leur odeur m’envahit, me portant un instant loin des relents viciés d’une vie qui pourrirait complètement en un rien de temps. Ma décomposition avait déjà commencé, depuis des heures, des jours, des semaines. Depuis qu’il était tombé malade. Je ne sais combien de temps encore je resterai moi-même ou celle que les autres veulent que je sois. Je me tournai pour prendre l’autre tasse, celle qu’il aurait utilisée, couleur crème avec son nom gravé dessus en élégantes lettres cursives rouges. Il aimait le thé à la menthe, il en abusait. C’était sa drogue quotidienne, il ne pouvait pas s’en passer. Je me souviens qu’un jour, nous avions oublié d’en faire une réserve. L’après-midi était froid même si le printemps avait commencé depuis longtemps déjà. Il pleuvait. Il se fâcha quand il ne trouva pas son thé à cinq heures de l’après-midi. Pas sur moi, il me dit d’emblée que je n’étais en rien responsable de sa stupidité. Il prit son manteau, enfila ses chaussures et disparut derrière la porte comme un fugitif poursuivi par la police. Je souris, amoureuse de sa gaucherie, de son attachement à des choses futiles. Il rentra une bonne heure plus tard, pestant contre les gérants du supermarché qui n’avaient plus les boîtes de thé en vrac de sa marque préférée, et qui ne les commanderaient plus. Il disait toujours que même les magasins n’étaient plus comme avant, qu’il vaudrait mieux achalander correctement les rayons des supermarchés plutôt que de dépenser de l’argent pour voyager dans l’espace. Il devait trouver une solution et se contenta ce jour-là de thé en sachet d’une marque de qualité inférieure. Puis, il me regarda, s’approcha de moi en souriant et me donna une rose rouge. « Elle ne vient pas du supermarché, je n’offrirais jamais une rose emballée à la femme que j’aime. C’est la première rose qui a fleuri sur le rosier du jardin où nous nous sommes rencontrés, tu te souviens ? Je la regarde depuis des jours et j’imaginais l’instant où je te la donnerais. Le thé n’était qu’un prétexte, je peux m’en passer. Mais pas de ton amour. À ça, je ne peux pas renoncer ! » Je l’embrassai et il resta immobile comme souvent. Il disait qu’il aimait sentir le goût de mes lèvres et que s’il m’embrassait aussi, il l’aurait gâché. Alors je l’embrassais encore, encore et encore tandis que lui, en silence, m’aimait toujours plus. Ce soir-là, nous fîmes l’amour. Ce fut différent, encore plus intense, plus profond et savoureux que d’habitude. La rose rouge nous observait depuis son vase, nous protégeait comme une garde de la Reine, immobile et digne, plus vivante que jamais. Je ressentis un frisson différent quand il jouit en moi, et je sus que quelque chose de grand, de puissant et d’incompréhensible pour l’homme avait pris racine dans mon corps à cet instant. Ni peur, ni douleur. Mais le fruit de l’amour qui quittait un corps pour se lier à un autre, captif d’une âme errante qui nous était confiée, guidée jusqu’à l’accomplissement complet de son périlleux voyage. Son premier voyage. Le miracle de la vie était en moi, pour la première fois. Ses yeux flamboyants d’amour et de passion cherchèrent les miens, d’où une larme avait commencé à jaillir. Dans cette larme et dans mon regard, il vit le reflet du vase et de la rose. Il s’arrêta, m’embrassa, me sourit. Il posa son index sur mon nez, m’arrachant un sourire comme toujours et me dit : « Elle s’appellera Rose. Tu aimes le prénom Rose pour une petite fille ? » Rose arriva neuf mois plus tard, comme un cadeau tombé du ciel. Elle était si gracile, sans défense et facile. Elle me souriait toujours, elle me souriait avec les mêmes yeux que son père.
Ma fille Rose, son mari Mike et mes deux petits-enfants Claire et Tommy venaient dîner chez moi. « Chez moi ». Je m’émerveillais de la facilité avec laquelle nous nous adaptons aux choses. Malgré tout, tout en tournant en rond comme un clown qui a reçu une gifle en plein visage, je ne voyais personne pour me parler, m’appeler, me rappeler encore une fois combien j’étais belle pour lui. Rose m’avait quittée pour quelques heures juste après la cérémonie, elle avait des choses à faire et devait payer la facture des funérailles. J’avais dû m’occuper des parents et amis encore présents, chacun d’entre eux souhaitant me rappeler à quel point mon mari avait été important pour moi, et combien je l’avais été pour lui. Ils parlaient, alternant les mots et les accolades froides de convenance, insipides, sans odeur, sinon celle de la naphtaline qui avait protégé leurs vêtements jusqu’à aujourd’hui et qu’ils avaient sortis pour l’occasion. Très souvent, les gens ne se retrouvent que lors de mariages ou enterrements, et ce fut le cas de beaucoup d’entre eux. Ce soir-là, leurs tenues seraient remisées dans leur housse en plastique, recouvertes de boules puantes de naphtaline, aves les mouchoirs encore pliés sur lesquels aucune larme sincère n’avait été versée. La prise de congé à tour de rôle me secouait. Les mots choisis et acérés comme les épines d’une coque de châtaigne heurtaient mon âme, tout comme leur attente de voir jaillir une larme de mes yeux, cette expression ultime de ma douleur, de ma vulnérabilité. Alors seulement, ils se sentaient payés en retour, et je pouvais percevoir leur ego s’exclamer « Il était temps ! Je suis enfin arrivé à lui arracher une larme ! » Et je les contentais, dans l’espoir de calmer mon chagrin, ma souffrance, le goût amer de la solitude qui m’attendait. Ils capturaient cette larme, la volant de mes yeux pour l’emporter comme souvenir, comme un trophée gagné dans la plus épuisante des batailles. Le prix de leur victoire était ma défaite et ils me tuaient chaque fois qu’ils disaient par après « Allez, ne pleure pas. La vie continue. »
Le crépuscule arrivait. Il passait toujours quelques minutes dans le jardin, suivant le soleil dans la dernière partie de son voyage vers la nuit. Je sortais rarement avec lui, je préférais rester tranquillement dans la maison à l’observer par la fenêtre, le rideau légèrement écarté, juste assez pour le voir sans courir le risque d’être découverte. S’il m’avait aperçue, il m’aurait certainement invitée à le rejoindre mais je préférais me remplir les yeux de cette carte postale monochrome, parce qu’elle me semblait beaucoup plus belle quand il était dessus. J’apercevais son ombre noire qui se fondait dans le paysage, la nouvelle tige entrée dans ma vie pour devenir premier arbre, puis bois patiné et enfin poussière enfermée dans un vase de métal gris et froid. Mais à l’époque, je ne voyais que mon arbre et la vision que cette position privilégiée à la fenêtre m’offrait me le rendait plus haut et puissant que tout le reste. Il restait là, immobile, le regard perdu dans le rouge feu du ciel qui ne voulait pas se rendre à cette nuit qui, perpétuellement, frappait à sa porte, lui demandant de s’écarter. « Qu’est-ce que la vie est belle ! », ces mots vibraient, galopaient dans mon cœur, traçant le long de mon dos une invisible série de frissons que je ne pouvais suivre sans secouer mon corps. « Le crépuscule comme acte final de la journée n’est rien d’autre que le début d’une nouvelle aube. Celle qui viendra, si nous l’avons méritée. » Nous avions aussi assisté au lever du soleil lui et moi. Ça arrivait souvent les nuits d’été, celles chaudes et étouffantes faites de silences interrompus par le bourdonnement fastidieux des moustiques assoiffés de sang, de vie. Ils ne nous piquaient pas mais nous empêchaient de dormir correctement. Quand nous étions au lit, tous deux éveillés, les yeux grands ouverts et les jambes écartées pour ne pas transpirer, nous occupions souvent notre temps en faisant l’amour. Mais un matin, il me surprit. De retour de la salle de bain, il s’approcha et me murmura à l’oreille : « Melanie, tu veux assister à la naissance d’une nouvelle vie aujourd’hui ? Ce sera une expérience nouvelle, qui te plaira ! » Je ne comprenais pas ce qu’il voulait dire. J’avais donné naissance à Rose il y avait longtemps déjà et j’avais travaillé quelques années comme infirmière et sage-femme dans un hôpital avant de fuir la ville de mon enfance. Pourquoi me demander si je voulais assister à un accouchement ? Je déclinai l’invitation, répondant que toutes les naissances étaient les mêmes et que j’avais déjà vécu l’expérience trop de fois, jusqu’à la nausée. « Mais le soleil naît chaque jour de façon différente. Les nuages dans le ciel, quand il y en a, offrent des nuances roses variées et uniques. Tu es sûre de vouloir rater ça ? Ça pourrait ne jamais se répéter, tu sais ? » Ces mots firent disparaître les dernières traces de sommeil et un instant plus tard nous étions assis sur notre banc dans le jardin, le plus beau, celui qui offrait la meilleure vue sur le lac. Nous restâmes collés l’un à l’autre, enveloppés de silence, tandis que la magie de la vie donnait naissance à un jour nouveau. Les moustiques étaient restés à la maison, dieux de la nuit qui craignaient la lumière de cette nouvelle journée, comme Satan craint la lumière de Dieu. Et le premier pleur du nouveau-né fut un faible rayon de soleil qui eut la force d’arriver jusqu’à nous, illuminant nos visages, réchauffant nos mains du mieux qu’il pouvait. Je l’embrassai. Lui, toujours immobile, pour savourer le goût de mes lèvres encore une fois. Je n’osai pas lui demander quel goût elles avaient, je le compris seule. Je compris qu’elles étaient spéciales pour lui, comme il l’avait toujours été pour moi. Spéciale comme la façon dont il m’avait fait accueillir cette nouvelle journée, le premier pleur de la vie. Unique comme la façon dont il était revenu habiter mon existence, emplissant ma vie de sa présence.
Rose entra dans la maison avec son jeu de clés. Elle était fière de ce bouquet de ferraille qu’elle désirait posséder depuis toute petite, quand elle me disait toujours que ses amies en avaient un, que leurs parents avaient décidé de leur donner parce qu’ils leur faisaient confiance. Elle ne comprenait donc pas que je sois d’un autre avis, et ne partageait pas mes craintes. Son père par contre était conciliant, comme toujours. La plupart des mauvaises habitudes que Rose avait eues portaient son inimitable signature. Dans mes moments d’exaspération, j’affirmais souvent avec énervement que, si Rose se perdait un jour, même un touriste de passage comprendrait de qui elle était la fille et la ramènerait. Rose était sa copie au féminin. Elle avait ses yeux, son nez, son grand front innocent, et sa peau blanche, presque pâle. Ils arrivaient à se comprendre par des discours faits d’interminables silences. Je me sentais souvent exclue et commençais à parler avec moi-même, pour me tenir compagnie. Pour ses seize ans, nous décidâmes de faire plaisir à Rose. Nous avions préparé un jeu de clés emballé comme un cadeau. Il avait pris une feuille du papier qu’il préparait lui-même et, avec le stylo réservé aux occasions spéciales, avait écrit : « Pour ma petite, qui devient une femme. » Il me l’avait tendue pour que je la lise, et peut-être attendait-il mon accord, mais je suis certaine que, si je lui avais dit que le texte ne me convenait pas, il n’aurait pas changé un mot de ce qu’il avait écrit dans son message. Je touchai plusieurs fois ce papier durant une partie de ma vie, vis souvent ces mots calligraphiés de sa main, l’encre noire légèrement floue qui couvrait à peine les imperfections de ce support artisanal. Quand Rose ouvrit ses cadeaux et trouva les clés, elle pleura. Au point que je craignis d’avoir commis une erreur. J’avais confirmé notre confiance en elle et ça, pour Rose, c’était extrêmement important.
***
« Salut maman, on est arrivés !
— Salut Rose, venez ! Salut Mike ! Salut mes petits anges ! »
Mike et mes petits-enfants me prirent dans leurs bras, Rose m’embrassa en me serrant fort contre elle. Claire était triste et, comme Rose, ne pouvait pas cacher ses sentiments. Tommy sautait comme un kangourou dans la maison, pour éliminer l’énergie accumulée.
« Claire, trésor ! Ne sois pas triste. Où as-tu caché ton beau sourire ?
— Claire a eu une mauvaise nouvelle aujourd’hui, dit ma fille Rose en lui caressant tendrement la tête. En plus de l’enterrement de son grand-père, elle a dû avaler le fait que Morgan, son petit ami, la quitte.
— Morgan t’a quittée aujourd’hui ? je lui demandai en feignant une expression exagérée de stupeur.
— Oui, ce fichu crétin ! Il m’a quittée avec un message téléphonique. Il n’a même pas eu le courage de me parler et de me regarder en face ce trouillard !
— Oh, je comprends. Et il dit quoi ce message ?
— Qu’il me quitte. Que veux-tu qu’il dise ?
— Les mots sont très importants, ma chérie ! Ils peuvent te faire comprendre s’il a peur, s’il a juste besoin d’un peu de temps, s’il y a encore de l’espoir ou si c’est vraiment fini pour toujours », je répliquai avec la fierté d’une femme qui avait accumulé une certaine expérience dans le domaine.
Choquée, Claire récupéra le téléphone dans sa poche. Elle appuya sur quelques touches avec une rapidité impressionnante, gestes qui me semblaient accomplis au hasard mais qui avaient un sens précis pour elle. Elle retrouva le message et me le lut.
« Alors, il dit : Pardonne-moi mais je pense que ça ne peut pas marcher entre nous. Je tenais beaucoup à toi, et toi à moi, je le sais. Mais c’est terminé. J’ai fait un autre choix. Je sais que tu me comprendras et que tu m’accepteras aussi pour ça, pour ma faiblesse et mon manque de courage. Ne cherche pas à me joindre, je ferai pareil de mon côté. Bonne vie Claire, adieu. C’est tout ! »
Elle éteignit le téléphone et le remit dans sa poche en essuyant d’un doigt une timide larme apparue dans ses magnifiques yeux bleus.
« C’est un garçon mature, Claire. Ses mots sont sincères et donc douloureux à entendre, surtout quand le cœur ne le voudrait jamais, venant d’une personne qu’on aime.
— Mature ou non, ça ne me concerne plus. Il a mon âge grand-mère et à quinze ans, on peut garder un peu d’immaturité ! s’exclama-t-elle. Je la laissai se défouler, c’était le mieux à faire pour le moment.
— On n’a pas les clés de la maison quand on est immatures, je dis avec un léger sourire vers Rose. Pas vrai, ma petite ?
— Mais… maman !
— Ça fait longtemps que j’ai les clés de la maison, grand-mère », répliqua Claire qui me les montra fièrement, avec une légère grimace. Je lui souris, Claire répondit, Rose baissa les yeux vers le sol, silencieuse et mal à l’aise.
« Moi aussi je veux les clés de la maison, moi aussi je les veux ! Papa, maman, quand est-ce que vous me les donnez ? Je veux jouer ! » cria le petit Tommy qui nous avait rejoints, amusé par le spectacle joué sous ses jeunes yeux par des acteurs improvisés, restés seuls pour remplir la scène de la vie.
Qui sait comment nous voyait cet enfant d’en bas, le regard toujours tourné vers le haut. Ces “étranges” adultes qui parlaient de choses “étranges” au lieu de rester tranquilles et de jouer avec leurs poupées. Peut-être se demandait-il où nous avions mis tous nos petits bonshommes, nos jouets. Peut-être aurait-il voulu les voir, les toucher, les prendre pour s’amuser avec nous. Et il les aurait animés de son imagination, leur aurait donné vie, formes et couleurs comme seul un enfant sait le faire. Pour lui, tout est un jeu, la vie même est un jeu. Toujours différent malgré des jouets toujours identiques, car personne ne peut mieux qu’un enfant évaluer toutes les alternatives possibles, pour les rendre réelles et les modeler dans son esprit. Alors, pourquoi ne jamais jouer, pourquoi se jeter dans les bras d’une vie faite de peur, de soucis et de problèmes ? En demandant les clés, il voulait entrer dans notre monde mais nous avions déjà dépassé la phase de l’insouciance, nous avions affronté celle de la conquête, de l’effort, avec succès. Et moi, contrairement aux autres, j’avais déjà goûté la saveur âcre de celle de l’abandon, par deux fois. Les autres, les plus jeunes, étaient encore arrêtés aux gares précédentes, à jouir du paysage, beau ou laid, attendant que le train de la vie les conduise autre part, sans savoir où. Ils pouvaient regarder en avant, à la recherche d’un but. Mais aussi en arrière, vers le point de départ, où leur monde avait commencé, dans le brouillard des souvenirs adoucis par le passage du temps. D’autres passagers les accompagnaient dans leur voyage, certains tristes, d’autres heureux, en bonne santé ou malades. Comme eux. Clones d’une civilisation qui veut faire de chacun l’égal de l’autre, une fourmilière qu’un être supérieur observe, où les “différents” sont considérés comme des anomalies, des fourmis qui marchent dans la direction opposée et ne trouveront jamais de miettes. Moi, je pouvais au contraire fatiguer mon regard en le tournant vers le début, vers mon passé, à travers la fumée dense où mes souvenirs se mélangent. Ils sont à moi, à moi seule, désordonnés et éparpillés comme des soldats morts sur un champ de bataille, qui n’avaient pas décidé où tomber, tués alors qu’ils tentaient d’accomplir leur mission et abandonnés là pour toujours, oubliés de tout et de tous. Si je regarde vers l’avant, je sais que la dernière gare de mon voyage n’est pas très loin. Je peux presque la voir, la toucher, la sentir. Atteindre ma gare d’arrivée est mon dernier projet, celui que j’accomplirai tôt ou tard. Et maintenant que mon dernier compagnon de route, entré dans le wagon à la moitié du voyage, l’homme qui était resté à mes côtés en me faisant sentir plus vivante que jamais, était descendu du train sans même me saluer, je me sentais plus proche de mon but mais en proie à la peur et à un total abattement. Il avait atteint la gare où sa vie, son voyage, arrivait à sa conclusion. Le prix payé pour son billet au début lui permettait d’aller jusque-là, pas plus loin. Ce sera parfois fantastique, grâce aux crépuscules qu’il verra de cet endroit, assis seul sur un banc dans une gare déserte. Je me demande si les rayons du soleil qu’il verra surgir à l’aube ressembleront à ceux que nous avons vus ensemble lors de nos matins, assis dans le train qui poursuivait son voyage sans que nous nous en rendions compte. J’attendrai mon crépuscule avec sérénité mais sans urgence, dans la fumée de mes souvenirs, attendant de me fondre en eux, de me transformer en un nouveau soldat tombé au champ de bataille et oublié là. À partir d’aujourd’hui, je ne serai que spectatrice et j’observerai les images de ma vie se déployer au-delà de la fenêtre du train en pleine course et, à chacune de ses secousses sur les rails, je me souviendrai que je suis encore ici. Je regarderai les passants et aiderai ceux qui, perdus dans leur existence, me demanderont des informations pour atteindre leur but. Mais je ne demanderai jamais à être écoutée et j’accepterai les critiques qui me seront faites sur la façon dont, simple femme de banlieue, j’ai affronté mon voyage. Et à l’arrivée de l’aube, il sera au pied de mon lit, comme une ombre sombre aux détails imprécis, qui me réveillera et me demandera de le suivre pour assister encore une fois à une nouvelle naissance, la mienne.
Claire me regardait, attendant peut-être une réplique de ma part qui alimente cette discussion stérile à mes yeux de femme âgée. Je pouvais faire plus pour elle, je pouvais lui faire un cadeau. Je la déçus donc, je ne relevai pas le défi, et capitulai, me mettant à nu devant elle.
« Claire, viens avec moi au jardin. Je te raconterai une histoire si tu as envie.
— Sur quoi grand-mère ? Pas de fable ou de truc de ce genre, je ne suis plus une enfant et je ne suis pas d’humeur à écouter des contes auxquels je ne crois plus depuis longtemps.
— C’est peut-être une fable mon enfant. Tu dis bien. Et c’est pour ça que quand j’y repense et prends conscience de son importance pour moi, je sens des frissons me traverser le corps dans tous les sens. Je te parlerai de ma vie, si tu veux m’écouter, pour que tu puisses la comparer avec la tienne et comprendre que malgré le fossé entre nos générations, nous ne sommes pas si différentes toi et moi. »
Claire fixa Rose un instant. Rose lui sourit, l’invitant à me suivre. Elle était émue, elle connaissait toute mon histoire dans les moindres détails, même les plus intimes, l’un deux l’ayant créée elle. Elle accepta mon invitation d’un hochement de tête silencieux, les yeux rivés au sol. C’était sa façon de me remercier. Le soleil au crépuscule brouillait les couleurs du monde, les rendant uniformes, une unique tache noire sans reliefs, privée de profondeur. Assises sur le même banc que celui où nous avions admiré la fin du jour tant de printemps, nous savourions ce monde qui nous apparaissait en deux dimensions, aux teintes indéfinies et floues, dépourvu de tout contour, pour tous, pour que personne ne puisse douter de sa beauté. Nos yeux fixaient l’arc-en-ciel de couleurs, du rouge intense près des arbres noircis par le soleil qui descendait, au bleu intense dû à la profondeur du ciel, tel qu’il nous apparaît quand on le regarde d’en bas. Ces couleurs se déliteraient bientôt, comme sur une aquarelle fraîche oubliée sous la pluie. Le rouge dominerait la terre pour ensuite laisser place à l’obscurité pressée de la nuit. Une nuit sans lune, une nuit étoilée.
Claire s’allongea, la tête posée sur mes jambes. Ses yeux bougeaient, s’arrêtaient sur des morceaux de ciel, pour compter les étoiles que l’on pouvait déjà apercevoir, bien que la lumière du jour ne se soit pas encore tout à fait éteinte. Peut-être y cherchait-elle une étoile en plus, celle qu’elle n’avait pas encore vue et qu’aucun observatoire, aucun télescope n’avait encore repérée. On dit que quand on meurt, on se transforme en étoile. Penser que ça pourrait vraiment arriver est agréable. Je la caressai et remarquai qu’elle pleurait. Je commençai alors mon histoire.
2.
Le matin du 13 septembre 1964, je suis montée dans le train qui me mènerait de Charleston, en Virginie-Occidentale, à Cleveland dans l’Ohio. J’avais trente-cinq ans, j’aurais dû être une femme mature à cet âge-là. D’un point de vue biologique, j’avais grandi, ça oui. Par moments, je me sentais même vieille. Je fuyais, quelque chose ou quelqu’un. J’échappais à une vie ratée, à un cumul d’évènements et de situations qui ne m’appartenaient plus. J’avais entendu dire que l’on comprend vraiment qu’on quitte un lieu pour toujours si, au moment du départ, on ne ressent pas le désir de se retourner pour regarder une dernière fois l’ultime photo de son passé. Je m’étais exercée pendant des jours, imaginant ce moment essentiel pour mon nouveau départ, le regard fixé droit devant moi, le passé s’effaçant à chaque pas. Si la vie avait été un ruban de satin, en regardant en arrière je n’aurais vu qu’un morceau de tissu déchiré, froissé et privé de sa couleur originelle. Noué ici et là pour marquer les principales étapes de ma vie, pour ne plus les oublier par erreur ou par volonté. Les étapes de ma vie, ou celle des personnes qui avaient toujours tout décidé pour moi, les tuteurs et garants de mon existence, assistants d’une pauvre fille aux facultés limitées, incapable de comprendre et de vouloir. Ils avaient pris possession de ma vie et y avaient cherché, et trouvé, une opportunité de racheter leur misérable existence. Je ne remarquais aucune différence entre mes choix et ce que l’on m’imposait, même si je me forçais à toujours en chercher une, pour me convaincre que c’était juste, que l’on m’avait appris ce qu’il fallait, que j’étais leur fille et qu’ils avaient donc le droit et le devoir d’exercer leur pouvoir sur moi. Même le plus extrême. J’entendais souvent ma mère pleurer dans sa chambre quand mon père n’était pas là. Des sanglots et des larmes amers étouffés dans un morceau de tissu, ces draps qui l’enveloppaient durant ses nuits d’insomnie, passées à penser à sa vie, sa vie volée par un homme qui ne la traitait pas mieux qu’il ne traitait ses chaussures. Il les faisait au moins briller de temps en temps. Et quand ce n’était pas le cas, ma mère devait y penser, sinon les coups pleuvaient. Je l’entendais souvent rentrer tard le soir, ivre mort, son stupéfiant refus de la vie noyé dans des barriques de gin et de whisky. Il criait, insouciant de l’heure et de sa femme qui dormait peut-être, ou qui veillait, inquiète pour lui, effrayée de l’état dans lequel elle allait le retrouver ou de ce qu’il lui ferait cette nuit-là. Mon père la frappait souvent. Il la battait si elle faisait semblant de dormir quand il entrait dans la chambre dans le noir, comme un fantôme, envoyant la porte battre contre le mur en tentant de rester debout. Il la battait si elle essayait de l’aider à se relever, à se changer ou à se coucher tout habillé. Tout allait bien, à condition que la nuit passe vite. Mais la nuit emportait aussi un peu de sa vie. Maman attendait que l’ogre soit endormi, allait à la salle de bain et tapotait les marques de coups avec un linge mouillé d’eau fraîche. Je l’entendais, j’entendais ses sanglots de douleur dûs aux coups qu’elle avait reçus dans le visage, un visage qui n’avait plus aucune expression, forme ou couleur. Elle venait ensuite me trouver. J’étais souvent éveillée, les yeux écarquillés par la peur de ce que je voyais chaque fois sur sa figure. J’étouffais mon ours en peluche dans mes bras, imaginant mon père, désireuse que ce soit lui ma victime de cette nuit. Cet ours était un des rares cadeaux que j’avais reçu de lui, pour mon anniversaire trois ans plus tôt, quand il était encore un homme bien à l’occasion. Grâce à lui, j’avais appris à détester mon prochain, alors qu’une enfant devrait au contraire apprendre à aimer. Ma mère me rassurait, me disait que tout serait bientôt terminé et que je n’avais rien à craindre parce que papa était seulement un peu fatigué, il avait eu une journée difficile et une vie compliquée, il avait dû supporter des situations douloureuses comme cette fois où un de ses compagnons de chambrée et meilleur ami était mort dans ses bras, déchiqueté par une de ces dizaines de milliers de grenades qui ont explosé durant la seconde guerre mondiale, où il avait combattu. Elle me le racontait toujours, ne se l’épargnait jamais. Voulant presque justifier le comportement de cet homme chez qui elle ne trouvait plus aucun des traits qui l’avaient attirée des années auparavant, la rendant amoureuse, convaincue qu’il était fait pour elle, et qu’elle avait épousé. Et pour lui faire plaisir, je faisais semblant de l’entendre pour la première fois, je restais en boule dans mon lit, en silence, et quand ma mère finissait son récit de ce soir-là, je m’approchais d’elle pour l’embrasser et caresser les marques de coups, pour comprendre à quel point elles pouvaient la faire souffrir. Elle interprétait ce simple geste de ma part comme un grand geste d’amour qui la récompensait de tout, qui la convainquait que, tout compte fait, continuer à vivre pour quelqu’un en valait la peine. Pour moi. Elle me demandait pardon en quittant lentement ma chambre. Je ne compris que plus tard qu’elle s’excusait de m’avoir mise au monde. Sur son visage martyrisé, ses lèvres dessinaient un faible sourire, qui me semblait rassurant, parce que je ne comprenais pas encore, je ne comprenais pas tout. Mais je savais ! Je savais que ma mère retournait dans l’antre de l’ogre. Et je cachais ma tête sous les couvertures, tremblante. Je voyais un ogre affamé avec des traits humains, ceux de mon père, que le pouvoir de mon imagination d’enfant rendait plus laids. L’ogre festoyait avec les restes de ma maman, déchirait ses chairs de ses dents effilées. Ces images étaient si réelles qu’il me semblait sentir l’odeur de son sang versé sur mon lit. L’ogre m’appelait, m’ordonnait d’entrer dans sa tanière et me tendait un morceau de son corps, sa main. Cette même main qui m’avait caressée quelques instants auparavant était maintenant inanimée sous le regard puissant de mon esprit. Souvent, ce cauchemar m’accompagnait toute la nuit et tout le jour suivant, bien que les ombres et les spectres qui habitaient l’obscurité aient cédé la place à la lumière du jour. Cette torture allait durer toute ma vie. Mais arriva quelque chose qui réussit à briser cet enchantement maléfique. Tout s’est évanoui à partir du jour où, de retour de l’université, j’ai trouvé ma mère morte dans la salle de bain. Elle baignait dans une mare de sang, les poignets lacérés par la lame froide et métallique d’un rasoir. L’ogre était entré en elle et l’avait combattue de l’intérieur, la consumant goutte après goutte. Mais le moignon de bougie, désormais fondue, ne laissait pas encore voir sa mèche et la flamme était encore allumée, bien que faible. Elle, petite et simple femme privée de son identité, avait trouvé le moyen de vaincre son ogre. Elle l’avait fait à sa manière, ce jour-là. Et ce fut sa plus grande victoire. Ce matin-là, ma mère m’avait confié pour la première fois son jeu de clés de la maison. J’avais enfin atteint mon objectif, l’âge adulte, j’avais gagné sa confiance sans mérite particulier. Mais, à mon insu, elle aussi sentait qu’elle avait atteint le sien. Elle avait vingt-deux ans quand elle avait commencé à s’occuper de l’ogre, à satisfaire seule tous ses désirs, même les plus malsains. Ses mains, ses pieds, et tout son corps étaient désormais dédiés à moi, rien qu’à moi. Je restais seule. Ma compagne de mésaventure m’avait abandonnée, trop fatiguée pour poursuivre le jeu avec moi. Fatiguée de tout, de la vie. Trois longues années sont passées avant que je ne parvienne enfin à me libérer de lui, années qui m’ont privée de toute dignité, dépouillée comme femme et comme être humain. J’ai cherché un emploi à l’hôpital comme infirmière et, étrangement, ils m’ont immédiatement acceptée. Ce fut mon premier vrai salut. J’ai jeté les horribles souvenirs de mon enfance dans la benne à ordures devant la maison et réuni les quelques guenilles encore bonnes, celles que je n’avais pas portées quand il me violait, qui n’étaient pas imprégnées de l’odeur de son sperme, de son vomi mêlé d’alcool et de mon sang. J’ai trouvé une maison à louer hors de la ville, pas très digne, mais on pouvait y vivre. En fin de compte, qu’est-ce que je savais de la dignité ? J’ai payé l’avance avec le peu d’argent que j’avais pu réunir grâce aux petits boulots que des voisins au bon cœur m’avaient confié. Ils connaissaient ma situation d’orpheline de mère suicidée, et celle dans laquelle je devais me trouver avec un mauvais père auquel ils avaient malheureusement eu affaire bien plus d’une fois. J’avais jalousement gardé cet argent dans un coffret en métal caché sous une planche du sol, en attendant que le bon moment arrive pour l’utiliser. L’ogre ne m’avait jamais permis d’aller travailler, il n’aurait jamais voulu que je gagne mon propre argent, que je devienne autonome et peut-être assez forte pour trouver le courage d’aller le dénoncer aux autorités. Il affirmait que l’autorité, c’était lui, et moi j’étais sa chose. Et je devrais le rester toute ma vie ou au moins jusqu’à ce qu’il décide de me jeter dehors à coups de pieds.
Quand tout a été prêt, j’ai attendu le soir avec impatience. J’ai suivi chacun de ses pas tandis qu’il se préparait à sortir, essayant de ne pas trahir mes émotions. Je repensais aux soirées précédentes, à comment je me sentais en voyant un père sortir de la maison et à ce qui arriverait après, quand l’ogre rentrerait à sa tanière à sa place. Je voulais tout répéter à ce moment, comme l’aurait fait un mime lors d’un de ses numéros, y compris les expressions de mon visage. Il s’est approché de la porte, l’a ouverte. Puis s’est arrêté et s’est tourné vers moi.
« Tu ne vas pas te coucher ?
— Pas encore.
— Pourquoi ?
— Je n’ai pas sommeil. J’irai bientôt.
— Comme tu veux. Mais ne te fatigue pas. Tu sais que je me sens mal si je te vois fatiguée. J’ai l’impression d’être un mauvais père. »
Mon cœur s’est arrêté un instant. Si la mort était arrivée à ce moment-là, je l’aurais accueillie à bras ouverts. Je n’ai pas répondu, l’ai regardé et fait un timide “oui” de la tête.
« J’ai été un mauvais père, Melanie ? » a-t-il continué comme s’il appréciait de poursuivre ce maudit interrogatoire. Réponds-moi putain ! J’ai été un mauvais père ? »
« Non », j’ai répondu en pleurant, secouant frénétiquement la tête pour confirmer une réponse à laquelle je ne croyais évidemment pas. Je tremblais. Il a attrapé mon oreille et l’a tordue avec force, avec une telle violence que je pensais qu’il allait me l’arracher de la tête ce jour-là.
« Bien, très bien. Ça va mieux maintenant, beaucoup mieux. Tu as toujours été une brave petite, très gentille. Tu dois toujours obéir à ton papa. C’est moi qui te fais vivre, comme j’ai entretenu ta pute de mère toute sa vie, comme un parasite. Et sois au lit quand je rentre ou ça ira mal, très mal ! On s’est compris ? »
Il a lâché mon oreille et est sorti en claquant la porte. Je suis restée quelques instants assise, le temps d’être sûre qu’il ne rentrerait pas pour prendre quelque chose qu’il aurait oublié, comme c’était déjà arrivé. Je me rappelle qu’un jour il était revenu deux minutes plus tard pour prendre un pistolet qu’il gardait caché dans un coffre, chargé et prêt à l’usage. Ce fut la première et dernière fois que je vis cette arme, je ne sais pas où elle a fini ou si elle a servi contre quelqu’un. Il avait vu que je le fixais pendant qu’il la glissait dans la ceinture de son pantalon, j’étais encore petite. Il m’avait regardée.
« Alors ? Qu’est-ce que tu as à regarder ? Remercie le Père Éternel que je ne l’aie pas encore utilisée contre vous ! »
Je n’avais pas bougé pas, pétrifiée, les yeux et la bouche grands ouverts dans une expression proche de la stupeur, la même que quand j’avais reçu l’ours en peluche, mais sans l’ombre d’un sourire. J’étais émerveillée que ses lèvres puissent prononcer le nom de Dieu. Je n’avais vu d’armes que sur quelques affiches jusqu’alors, la télévision n’existait pas, et je ne savais pas à quoi cet objet pouvait servir, et pourquoi il était tellement fâché d’avoir été découvert. Ma mère est arrivée à mon secours.
« Viens chérie, viens avec moi. Papa a beaucoup de choses à faire, il n’est pas fâché sur toi. Tu ne dois pas penser ça, d’accord ?
— D’accord maman. »
Ses mains étaient sur ma bouche, serrées si fort que je réussissais à peine à lui répondre, comme si elle voulait bloquer une de mes phrases hors de propos. Ou m’étouffer, pour m’épargner toutes les douleurs que, elle en était sûre, je devrais subir dans les années à venir. Ses mains sentaient le savon. J’adorais ce parfum de fleurs, le parfum de maman.
Il n’est pas rentré. Durant ces quelques minutes d’attente, j’avais trompé le temps en goûtant mes larmes, essayant de me rappeler quand, par le passé, elles avaient eu cette saveur. J’avais un large échantillon de choix possibles, mais aucun ne semblait correspondre à un déjà connu. J’avais découvert un goût nouveau, mes larmes s’étaient légèrement adoucies. J’ai couru dans ma chambre, rassemblé mon argent et l’ai glissé dans ma valise. J’ai descendu les escaliers sur la pointe des pieds, ouvert la porte et regardé dehors, effrayée de le trouver là devant moi à me dire : « Je t’avais prévenue, tu aurais dû m’écouter morveuse ! Tu vas passer un sale quart d’heure ! » Mais il n’y avait pas trace de son ombre, il n’y en aurait plus. Un pas, deux pas, trois pas. Toujours plus rapides, précipités. J’ai pris l’allée à droite, vu Monsieur Smith sur le seuil de sa maison arranger des fleurs dans des vases posés sur les marches de l’entrée. Ses enfants Martin et Sandy tournaient autour comme des papillons autour d’une belle fleur. Il plaisantait avec eux et son épouse, qui les avait rejoints, les regardait en souriant. J’ai ralenti pour mieux observer cette scène de famille heureuse, celle que je n’avais jamais eue, et l’emporter avec moi en faisant semblant qu’elle était un peu la mienne.
Les cinq années qui suivirent, mon père ne chercha jamais après moi. Du moins, personne ne m’a jamais dit qu’il l’avait fait. Quand je suis retournée à la maison à contrecœur le jour de son enterrement, les voisins m’ont raconté que lorsqu’il était revenu, la nuit de mon départ, ivre mort comme toujours, il s’était mis à crier et à alarmer tout le voisinage. Personne ne m’avait vue sortir, personne n’avait pu répondre aux questions qu’il avait bafouillées d’une bouche empoisonnée par l’alcool. Ils m’ont aussi dit que, grâce à des connaissances peu recommandables, il avait appris où j’étais mais avait décidé de me laisser tranquille, de ne pas me poursuivre, parce qu’il savait qu’il avait été un mauvais père et qu’il ne me ferait que du mal si je devais revenir chez lui. J’avais décidé de partir, ça lui convenait. Quelqu’un affirmait qu’il avait décidé de récompenser mon courage, la capacité à l’envoyer dans les cordes dont j’avais fait preuve. Je n’ai pas cru un mot de tout ce que ces gens qui ne me connaissaient même pas me dirent, mais j’ai pensé que ça pouvait aussi être vrai, parce que de toute façon rien de ce qui le concernait n’avait plus d’importance. L’ogre était mort, tué par un autre ogre durant un règlement de comptes, peut-être.
Il était environ neuf heures du soir le 15 septembre 1960. Depuis trois jours, il pleuvait à verse, sans arrêt, et ça allait encore durer. J’étais rentrée du travail depuis peu, je faisais souvent des services un peu plus longs pour gagner plus d’argent. Au bout de cinq ans, j’en avais suffisamment pour décider de m’acheter ma propre maison, aidée par un petit prêt bancaire. Ma vie avait changé, je trouvais enfin mon identité. Faible peut-être mais mienne. Le travail m’y avait beaucoup aidée, il m’avait permis de rafistoler les blessures accumulées, et toujours douloureuses sous les nombreuses cicatrices éparpillées sur mon corps. Une douleur diffuse, plus supportable, bien que continue, mais qui n’autorisait pas le repos de l’âme. J’ai réchauffé mon repas préparé dans le four et me suis assise à table en attendant qu’il soit prêt, mes mains supportant le poids de ma tête.
La télévision existait depuis quelques années mais seules les familles les plus riches pouvaient se permettre d’en acheter et entretenir une. Sûrement pas moi. Les rares fois où quelque chose d’intéressant était transmis, je m’arrêtais devant les vitrines des magasins d’électroménager avec d’autres qui, comme moi, ne pouvaient se l’offrir. Mais à l’heure de la fermeture, le même petit homme grassouillet et moustachu s’approchait de nous, protégé par la vitrine, pour annoncer en écartant les bras tristement que “les émissions étaient finies pour aujourd’hui ” ou que le surlendemain il y aurait “d’excellentes offres en magasin auxquelles nous ne pourrions pas résister pour enfin ramener à la maison notre première splendide télévision”. Ces mots étaient écrits sur son visage, il n’avait pas besoin de les prononcer. J’ai aussi essayé de me réfugier dans des bars, ceux qui avaient une télévision pour les clients, surtout durant les froids mois d’hiver ou les soirs de pluie. Mais les odeurs de vapeurs d’alcool me montaient à la tête, me rappelant mon père et me faisaient fuir comme un détenu à la recherche du chemin de la liberté.
J’avais une vieille radio à la maison, que j’allumais de temps en temps, quand l’envie me prenait d’entendre une voix suffisamment lointaine et qui ne demande aucune réponse, aucune interaction avec moi. Je l’avais trouvée sur un étal d’occasions, en vente pour quelques dollars. Elle était cassée mais le vendeur m’avait assurée que ce serait facile à arranger. Je l’avais achetée, pas totalement convaincue d’avoir fait une bonne affaire, et un ami m’avait proposé de me la réparer gratuitement. Il s’appelait Ryan. Ce garçon fut le seul homme capable de m’offrir un peu d’amitié saine et inconditionnelle, celle dont j’avais désespérément besoin, dont je n’avais jamais eu la chance de profiter de toute ma vie. Sous plusieurs aspects, je restais plutôt renfermée avec lui mais, tandis que les autres se sentaient dans l’obligation de sonder mes faiblesses, lui les respectait. Ryan ne me demanda jamais rien qui concerne mon passé, il ne jugea jamais le bon ou le mauvais de ma conduite et des quelques choix que j’avais faits depuis que j’avais commencé à vivre comme une femme libre. Il comprenait quand j’avais envie de parler parce que je déversais tout comme un fleuve en crue et il se laissait submerger. Il acceptait ma fragilité, exprimée par mes silences, quand je préférais rester seule à contempler une feuille de salade posée sur la table de la cuisine. Quand il voyait arriver un de ces moments récurrents, il me faisait un salut militaire et s’éloignait de moi d’un pas martial, sans parler, fermant doucement la porte derrière lui. Il me faisait rire, me faisait me sentir bien. Comme je n’avais jamais ri et comme je ne m’étais jamais sentie dans ma vie. J’éprouvais quelque chose pour lui, un sentiment étrange que je ne pouvais reconnaître, sans nom. Quand un jour, nous étions sur le point de nous embrasser, je l’ai repoussé avec force. J’avais eu peur. Je n’ai pas compris de quoi à l’époque mais je savais que c’était de la peur pure. Mais mon geste ne l’a pas ébranlé et il a continué à se comporter de la même façon avec moi. Un jour, il m’a dit que sa famille déménageait à cause du travail de son père et de certains problèmes qu’il devrait affronter. Il ne m’a jamais dit où il allait vivre, pour une question de sécurité. Nous devions donc nous éloigner l’un de l’autre quelques temps et je ne pourrais le joindre en aucune façon. Mais je n’avais rien à craindre car il me chercherait, nous resterions en contact et il me donnerait signe de vie dès que les choses se seraient calmées.
« Je te le promets Melanie. Donne-moi ta main, pose-la ici et écoute. Tu sens battre mon cœur ? » ont été les derniers mots qu’il a prononcés tandis qu’il posait ma main sur sa poitrine, avant son dernier salut militaire, la dernière marche qui annonçait son départ. Je n’ai pas répondu à ses mots avec les miens, que j’aurais pourtant voulu dire, mais qui s’étaient bloqués dans ma gorge, nouée par les larmes, sans plus pouvoir respirer.
À travers cette radio, qui me rappelait sa présence dans ma vie, je subissais passivement les émissions, les actualités, les bulletins météo, les chansons des Beatles, d’Hendrix, d’Armstrong et des Rolling Stones. Depuis quelques années, un petit jeune avait fait son entrée sur la scène musicale. Il s’appelait Elvis Presley, un joli cœur qui affolait les filles quand il chantait en faisant des mouvements de hanches lors de ses prestations. Les jeunes ne se souciaient pas d’utiliser une bonne partie de leur salaire pour acheter ses disques ou assister à ses concerts animés, rêvant peut-être de se jeter dans le vide et d’être récupérées au vol par ses bras puissants. La fièvre pour ce beau garçon de Memphis m’avait atteinte aussi. J’avais trouvé un de ses disques dans un magasin et l’avais acheté même si je n’avais pas de tourne-disque à la maison. Je l’avais laissé bien en vue pendant des mois, à prendre la poussière. Je l’adorais en silence, il m’arrivait de m’arrêter plusieurs minutes pour le regarder et chaque fois que je recevais mon salaire, l’envie me prenait d’acheter un tourne-disque pour pouvoir enfin l’écouter. Pour les filles de vingt-huit ans, comme moi, Elvis était le sujet qui monopolisait les conversations entre collègues, les pauses déjeuner, chaque moment de la journée. Il faisait un bon parti à tous points de vue. Mes collègues, “les autres” comme je les appelais souvent, décrivaient avec force détails les pensées érotiques qu’elles nourrissaient pour lui. Certaines avouaient qu’elles n’auraient aucun scrupule à quitter mari et enfants si le “beau garçon” leur avait donné le moindre espoir. Je ne comprenais pas vraiment ces discours, je n’étais pas capable de mesurer la force de la source d’énergie qui les alimentait. Mais quand on parlait de sexe, j’éprouvais une sensation de malaise brut, je sentais l’aversion naître et grandir en moi, dans mes entrailles, me prenant en tenaille comme deux mains serrées autour de mon cou pour m’étouffer. Le sexe me rappelait l’ogre, la souffrance, la douleur et toutes les humiliations que j’avais dû subir, le goût du sperme d’un homme mauvais répandu sans contrôle sur mon jeune ventre, sur ma peau innocente qui n’aurait dû connaître que la pureté et la pudeur, mon sang et celui de ma mère versé chaque jour sur les draps blancs d’un lit toujours défait. Mon entourage s’est aperçu que quelque chose n’allait pas. Certaines ont choisi de ne pas s’en mêler, une autre l’a fait, sous le prétexte fallacieux de m’offrir son aide précieuse.
« Rien, pourquoi tu me poses la question ?
— Comme ça. Tu es très bizarre.
— Je suis comme ça, on ne peut rien y faire, je répondis en ouvrant les bras, signe que je m’étais résignée au destin de ma vie.
— Tu préfères les femmes ?
— Pardon ?
— Je t’ai demandé si tu préfères les femmes, si tu les aimes.
— Les femmes ? Ne dis pas de bêtises, enfin !
— Pendant toutes ces années, tu ne nous as jamais raconté une expérience sexuelle avec un homme, alors qu’on l’a toutes fait. Ok, peut-être que tu n’en as pas encore eue mais tu voudrais peut-être, et tu pourrais comparer avec nous. Et qu’est-ce que tu fais ? Tu te renfermes dans ta coquille comme une huître ! »
Comment lui dire que ma “première fois” était à l’âge de cinq ans avec mon père ? On m’avait dit que ce serait un jeu. Comment la convaincre que ce jeu pensé pour moi et qui consistait en réalité en une exploration éhontée de mon intimité ne m’avait pas plu du tout parce que, à cet âge, j’aurais préféré jouer avec des poupées comme toutes les petites filles ? Comment lui crier en plein visage que si je n’avais pas joué avec lui, il aurait contraint ma mère à se soumettre aux mêmes pratiques, au même jeu, mais avec d’autres règles bien plus sévères, adaptées aux adultes ?
« C’est une conversation que ne je n’ai pas envie d’avoir, sans raison particulière. Peut-être que je ne suis pas encore prête ou peut-être que je ne le serai jamais. C’est comme ça, point.
— Ok Mel, comme tu veux. On se retrouve ce soir pour une soirée pyjama. Tu te joins à nous ?
— Il y aura des hommes ?
— Non.
— On parlera de sexe ?
— Aucune idée, mais je crains que oui.
— Alors non, merci. Je n’aurais rien à dire et je serais un poids pour vous toutes. »
Quand je suis rentrée ce soir-là, j’ai pris le disque d’Elvis et l’ai jeté à la poubelle.
J’ai entendu la sonnette une fois, puis une seconde, avant que je n’atteigne la porte.
« J’arrive ! » j’ai crié d’une voix forte.
Quand j’ai ouvert, je me suis retrouvée face à un policier. Il pleuvait à verse. Son uniforme était trempé bien qu’il soit descendu de sa voiture garée à seulement quelques pas de la porte de la maison. Un de ses collègues était encore assis à la place du conducteur et regardait vers nous, le corps tendu vers l’avant et les yeux tournés vers le haut pour mieux encadrer la scène à travers la vitre.
« Bonsoir, monsieur l’agent, je dis surprise.
— Bonsoir. Vous êtes mademoiselle Melanie Warren ?
— Oui, monsieur l’agent. Qu’est-ce qu’il se passe ? »